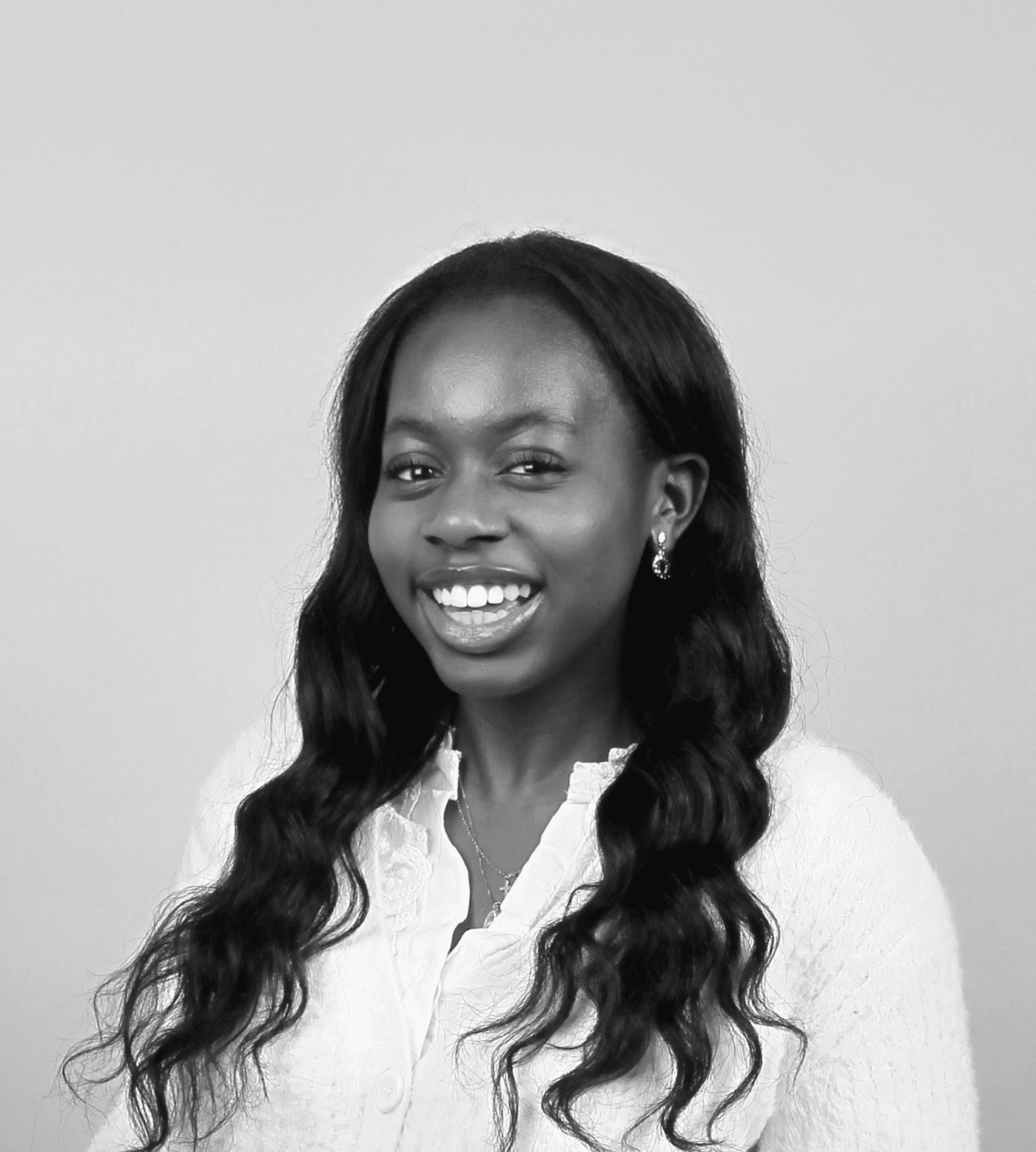Isabelle Moine-Dupuis Maître de conférences à l’université de Bourgogne, Centre de recherche sur le droit des marchés et des investissements internationaux (CREDIMI) [vc_btn title= »Télécharger l’article » color= »primary » link= »url:http%3A%2F%2Fconfrontations.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2FConfrontations-Revue-128-Bien-commun.pdf||target:%20_blank| »] L’épidémie du Covid-19 nous a violemment rappelé le statut particulier de la santé et par là même du médicament qui ne saurait être considéré comme un produit industriel comme un autre, car son « consommateur » est d’abord un patient. Isabelle Moine-Dupuis introduit la notion de « bien commun ». C’est prouvé, ou plutôt éprouvé. Une seule pathologie peut plonger la société internationale dans une désorganisation et un désarroi que nul n’imaginait quelques mois auparavant. Elle révèle que la santé n’est pas un à-côté de l’économie et de la vie sociale, mais un pilier essentiel. La pandémie du Covid-19 met aussi à nu les fragilités de nos systèmes de santé. Les pénuries en médicaments et les difficultés de l’ensemble des populations d’accéder à
Ce contenu est réservé aux abonné(e)s. Vous souhaitez vous abonner ? Merci de cliquer sur le lien ci-après -> S'abonner