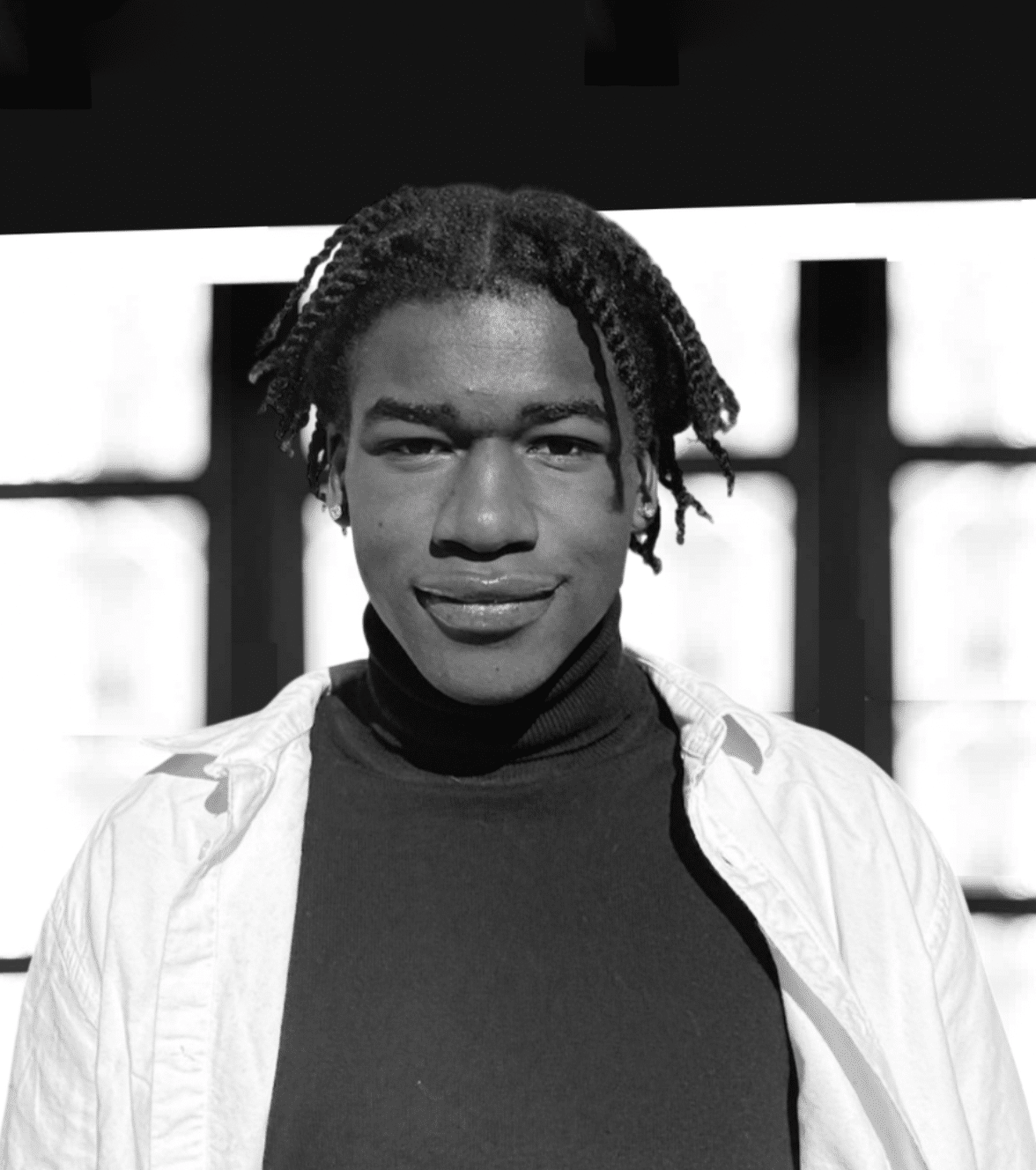Par Paschal Donohoe, Président de l’Eurogroupe – LA REVUE #136. Alors que les deux premières décennies de l’euro en remplacement des monnaies nationales ont été difficiles, les niveaux de revenu et le niveau de vie dans la zone euro ont continué de s’améliorer avec un niveau élevé de convergence économique. C’est un signe concret de la façon dont l’euro, en tant que projet politique, a réussi à résister à des tempêtes très différentes tout au long de son existence et à tenir son engagement à construire un avenir commun qui nous aide à accomplir beaucoup plus collectivement qu’individuellement. En janvier, nous avons accueilli la Croatie en tant que vingtième membre, prouvant une fois de plus l’attrait et la résilience de notre monnaie commune, même en cette période de grande incertitude et de grande difficulté. L’impact humanitaire de l’invasion de l’Ukraine par la Russie est au premier plan de nos préoccupations,
Ce contenu est réservé aux abonné(e)s. Vous souhaitez vous abonner ? Merci de cliquer sur le lien ci-après -> S'abonner