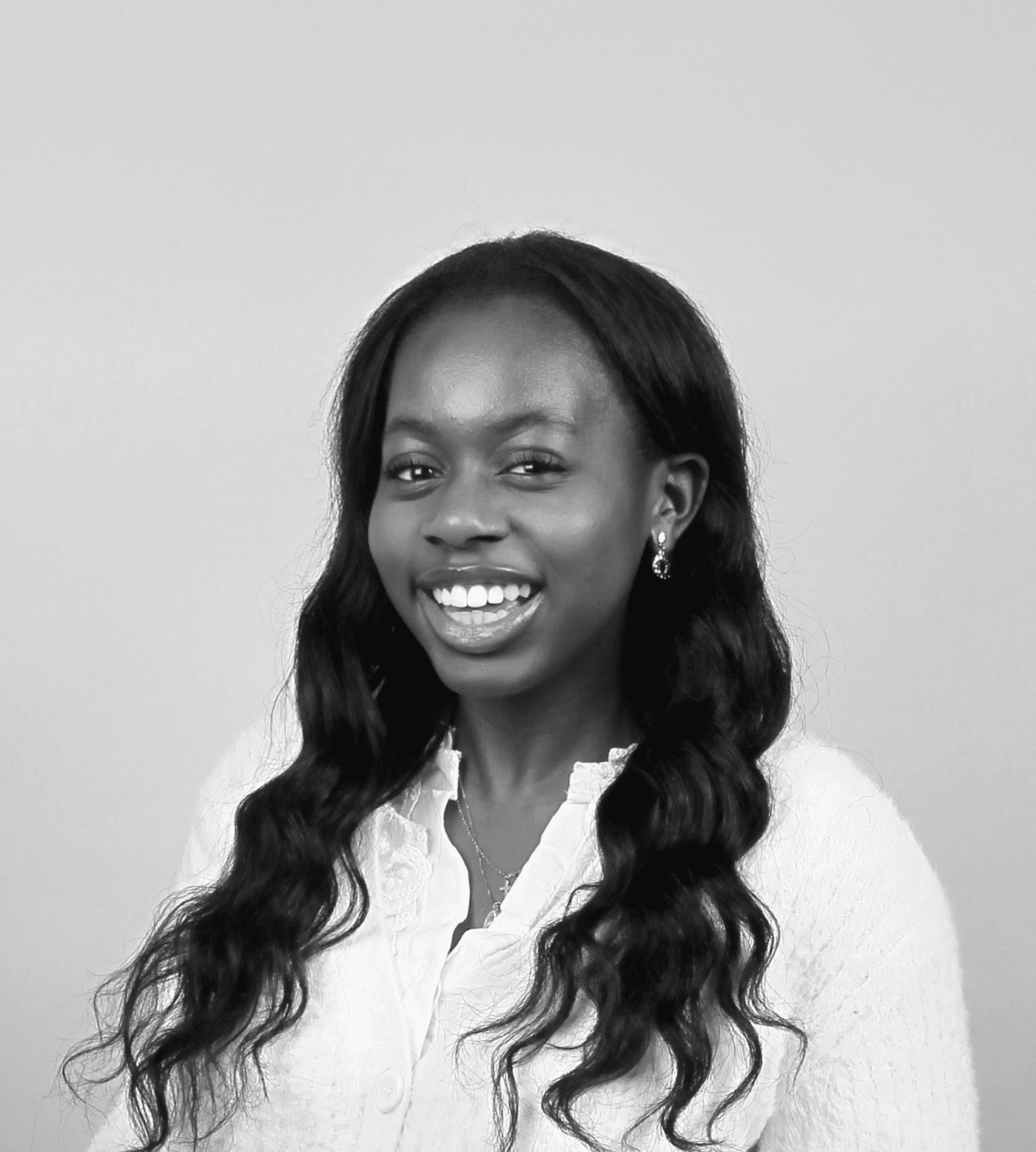- Mireille BATTUT (modératrice), membre du Conseil d’Administration de Confrontations Europe
Commençons par une première question générale après le diagnostic assez rude de la première table ronde. Partagez-vous ce diagnostic ? Quels éléments de celui-ci vous ont particulièrement accroché ? Et, qu’attendez-vous du niveau européen pour transformer le capitalisme ?

- Pervenche BERES, députée européenne de 1994 à 2019
Je voudrais d’abord revenir au thème qui nous réunit, qui est le thème du capitalisme. On a vu dans la précédente table ronde à laquelle vous nous invitez à réagir qu’il fallait définir le capitalisme. Mais de quel capitalisme parle-t-on ? Avant de lui ajouter une épithète pour savoir s’il s’agit du capitalisme chinois, anglo-saxon, continental, social, que sais-je encore, le capitalisme en soi, me semble-t-il ne peut pas résoudre les questions que vous soulevez.
Le capitalisme en soi, c’est la mobilisation d’un facteur de production au service de sa propre stratégie, qui est une stratégie du profit et du court terme. On a forcément besoin de compléter cette définition du capitalisme et donc de parler de tout le reste. Et ce qui, me semble-t-il, doit être mobilisé aujourd’hui, c’est ce « tout le reste ». Il se trouve que le capitalisme aujourd’hui prend des expressions, des forces et des dynamiques qui obligent aussi les acteurs à poser la question de leur force en tant qu’Union européenne. De ce point de vue-là, l’Europe a découvert un nouvel horizon : elle est un élément régional dans un univers multilatéraliste et finalement très menacé, très fragilisé. On est dans une situation assez paradoxale. En France, le vocabulaire a évolué : il y a une quinzaine d’années, tout le monde rêvait d’Europe puissance, ensuite d’Europe qui protège. Maintenant, le nouveau slogan, leitmotiv est celui d’une Europe souveraine. Or, cette question va se poser à nous à un moment où les outils qui ont été pensés pour fabriquer la souveraineté européenne sont les plus menacés. On voit bien que dans la gouvernance européenne – et la Commission Von der Leyen n’y fait pas exception, la question de l’intergouvernementalisme versus la méthode communautaire est une question d’une actualité criante. Au moment où il faudrait exercer notre souveraineté, on aurait besoin de la méthode communautaire. Or, nous sommes dans une dynamique très intergouvernementale.
J’ai entendu dans la précédente table ronde et dans l’échange avec les partenaires, quelque chose qui est d’une actualité tout à fait criante. Nous ne sommes plus au 19ème siècle, les acteurs, les stakeholders, les partenaires de l’entreprises ont changé, ça n’est plus le modèle du capital, du travail et éventuellement de l’Etat régulateur. Il y a un quatrième acteur qui a pris une dimension tout à fait essentielle, qui est ce qu’on appelle la société civile et les ONG. Cela change radicalement la donne sous beaucoup d’aspects pour l’entreprise. Et cela l’oblige aussi à devenir acteur. Pour autant, je ne crois pas à l’idée que l’entreprise puisse être la source principale de création de sens, de bien commun et de valeurs. Parce que si on dit les choses brutalement, ça nous ramène à l’autorégulation et ça n’a jamais marché. Et ça nous a même mené à des catastrophes. Donc la question de la co-construction du bien commun me semble tout à fait essentielle. Je veux juste répondre à mon ami Kosta Botopoulos, qui a eu la gentillesse de dire que la question de la mutation de l’UMC et la création d’un budget de la zone euro était la chose la plus facile ; je crois que c’est la chose la plus difficile. Pendant 25 ans, je me suis occupée de la création d’un budget de la zone euro et j’ai dû renoncer à la présentation de mon dernier rapport que je co rédigeais avec un collègue de la CDU, sur la base donc d’un grand compromis, parce que je savais que je n’avais pas de majorité. Quand on bute sur un os comme ça, il faut trouver la voie de contournement. La voie pour moi est non pas sur l’outil, mais sur le bien commun. C’est pour ça que je crois qu’Ursula Von der Leyen a raison de mettre la question du Green New Deal en fil conducteur de sa Commission : mais il faut être consistant, il faut être sérieux derrière. Si on veut être cohérent avec la transformation de l’économie européenne, pas uniquement pour des raisons climatiques mais aussi pour des raisons de respect de la biologie, et en parallèle, et non pas après, de la lutte contre les inégalités et de la question d’un new deal social qui est incontournable si on veut avoir un vrai Green New Deal, la question des 3% se posera. Il faut saisir cette nouvelle perche mais assez vite pour ne pas redévelopper de l’acrimonie avant d’avoir trouvé des solutions. Il y a des éléments pour que cette nouvelle Commission, sous l’impulsion de la société civile, de tous les acteurs, réinvestisse l’entreprise dans un modèle européen qui permettre un capitalisme au service d’un bien commun.
- Jean-Jacques BARBERIS, Membre qualifié, Finance for Tomorrow
Puisqu’il y a beaucoup de rocardiens autour de cette scène, cela me rappelle une très belle citation de Michel Rocard. Quand François Hollande lui a remis la Grand-Croix de la Légion d’Honneur, Michel Rocard a fait un très beau discours assez théorique. Il a eu une très belle phrase « le capitalisme peut faire mais il ne veut pas. En Scandinavie, le socialisme l’y a contraint. » Je trouve que c’est une très belle phrase qui rappelle un certain nombre de choses qui fera peut-être plaisir aux rocardiens autour de cette table.
Au-delà de l’anecdote, je parle aujourd’hui au nom de Finance for Tomorrow, qui est l’association de la place financière de Paris qui fédère des acteurs qui s’intéressent aux questions de finance durable et de finance soutenable et qui essaye d’intégrer dans le capitalisme financier court-termiste traditionnel d’autres enjeux. Je vais vous livrer quelques réflexions sur ce qui nous semble absolument essentiel au niveau européen dans les années à venir pour essayer d’intégrer ces enjeux, dont justement celui d’un nouveau mode de développement.
J’aimerais faire un parallèle entre deux événements qui ont lieu aujourd’hui : d’une part, la COP qui se tient à Madrid et qui prépare ce qui sera la COP véritablement importante, celle de Glasgow l’année prochaine, au cours de laquelle les Etats s’accorderont sur le renouvellement de leurs engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et d’autre part, je pense qu’il n’aura échappé à personne que nous vivons dans un mouvement de contestation sociale assez massif en France. Dans ce contexte-là, a fuité la proposition de Green Deal européen, ce qui est intéressant puisque d’une certaine manière même l’appellation de Green Deal européenne rapproche deux sujets fondamentaux : un sujet social avec une idée de relance keynésienne et d’autre part, la question de la transition. Pour FinanceForTomorrow, c’est un sujet dont il faut s’emparer au niveau européen. Quand on a organisé le Climate Finance Day la semaine dernière, on a mis au cœur de nos travaux la question de la transition juste. Ce n’est pas une question très développée en France et en Europe.
Cette notion est extrêmement importante, car elle est probablement au cœur de la manière dont il faut envisager un nouveau mode de développement européen. La notion de transition juste signifie simplement que la transition écologique et énergétique dans laquelle on va s’engager ne sera possible que si elle est fondamentalement socialement acceptable. Dit comme ça, ça peut paraît une évidence quand on a connu l’épisode des gilets jaunes, parti d’une étincelle fiscale sur des questions de fiscalité environnementale mais je pense que c’est beaucoup plus profond et il faut l’avoir en tête. J’ai vécu, à l’époque comme négociateur pour le compte de la France, l’échec des négociations onusiennes sur le climat à Copenhague. Cet échec était grandement lié à la crise dans laquelle était plongée l’Europe occidentale. D’une certaine manière, la crispation sociale des sociétés était telle qu’il était impossible de s’engager dans la transition. Le premier point, c’est qu’une société socialement crispée aura du mal à s‘engager dans la transition. D’une certaine manière, la pire chose qui peut être devant nous, c’est si une nouvelle crise financière arrive et qui détourne tout le monde de l’objectif climatique.
Ensuite, il y a une raison macroéconomique pointée par l’OCDE : quand on mène des politiques de décarbonation de l’économie, quelles qu’elles soient, il y a un impact de redistribution relativement important. Si on fait tout transiter correctement, l’OCDE estime qu’au niveau mondial la décarbonation touche 0, 05% des emplois. C’est peu et en même temps absolument énorme, car avec des impacts redistributifs sectoriels ou géographiques qui sont immenses. D’une certaine manière, on ne peut pas en vouloir à certains pays européens de l’Est de considérer qu’ils ont des problèmes de sortie du charbon dans certaines régions. Cela veut dire qu’une politique de transition énergétique et de transition climatique au niveau européen appelle fondamentalement aussi des mécanismes de redistribution sociale pour la rendre acceptable et possible. On pourra discuter des outils, mais on a d’abord besoin, avant d’outils, au niveau européen, d’équipements intellectuels pour appréhender ces sujets-là. Je prends un exemple : celui des réflexions, il y a dix ans, sur la première taxe carbone en France. C’était Jean-Louis Borloo qui les menait. La théorie en vogue à Bercy, c’était la théorie du double dividende : vous taxez les externalités et vous faites de la réduction du déficit budgétaire. Aujourd’hui, ce dont on a besoin, c’est de se rééquiper intellectuellement pour faire du double dividende social. On a dans certains Etats américains un certain nombre de parlementaires qui imaginent des solutions : on fait du double dividende, on taxe le CO2 au niveau des individus, mais par contre, on le redistribue entièrement. Plus vous êtes riches, plus vous émettez, plus vous êtes taxé. Les dividendes sont reversés au profit des plus modestes pour faire de la transition. C’est ce type d’outils au niveau européen dont on a besoin. Ce qui m’inquiète dans le projet de Green Dal qui a fuité il y a quelques jours, c’est que je n’ai pas vu à un moment le mot social. Or c’est une attente très forte et qui permettra de faire la transformation correctement.
- Patrice PELISSIER, Ancien président du directoire de MEA AG, Consultant
Je voudrais rebondir sur le premier panel et sur la question de la crise du capitalisme, pour d’abord faire une observation relative au fait que le sujet de la crise du capitalisme est un sujet vu de façon assez différente en Europe du Nord, Europe du Sud et Europe Centrale. En Europe Centrale, à Prague, à Varsovie ou à Budapest, les gens tombent de leur chaise quand on parle de crise du capitalisme. Il n’y a pas de crise du capitalisme en Pologne. Même après la crise de 2008, la Pologne a toujours eu une croissance positive. Elle a une croissance de 4,1% par an sur les quinze dernières années. La République tchèque a une croissance moyenne de 3% par an sur cette même période. L’idée même d’une crise du capitalisme est une idée qui leur est vraiment étrangère. J’ai été dans les pays baltes pendant trois semaines au mois d’août. Quand vous êtes à Riga, à Tallin, à Vilnius, vous n’avez pas l’impression que le sujet d’une crise du capitalisme soit à l’ordre du jour dans ces pays-là. La perception qu’ils ont est très différente de celle qu’on peut avoir en France notamment et dans d’autres pays d’Europe du Sud. Puis, vous avez l’Europe du Nord, notamment l’Allemagne, où je réside depuis 30 ans mais aussi en Autriche, aux Pays-Bas ou en Scandinavie, où l’expression de crise du capitalisme n’est pas couramment employée. Les gens pensent qu’il y a des problèmes de redistribution, des problèmes d’inégalités, des problèmes de durabilité du développement. Cette idée qu’il y aurait une crise du capitalisme, même en plein cœur de la crise de Lehman Brothers, ce n’était pas un vocabulaire qui était usité en Allemagne par exemple.
C’est pour dire que la perception des choses entre l’Europe du Nord, l’Europe de l’Est et l’Europe du Sud n’est pas la même. Cela veut dire que l’approche européenne est compliquée, car la perception diffère.
Mon deuxième point, c’est que je suis de ceux qui pensent qu’il y a effectivement une crise du capitalisme. Quelle est cette crise ? Pour reprendre ce qu’a dit Philippe Herzog, c’est d’abord une crise de la régulation ; c’est-à-dire à l’articulation entre la politique monétaire, la politique budgétaire et la politique du taux de change. L’autre aspect souligné également par Philippe tout à l’heure, c’est un déséquilibre croissant entre la rentabilité du capital productif et celle du capital financier. Ces sujets ne sont pas spécifiquement européens, mais concernent bien d’autres zones géographiques que l’Europe et sont en fait globaux.
Dans la mesure où l’approche européenne est compliquée, car la perception d’une « crise du capitalisme » est très différente au sein des différents Etats membres de l’UE et puisque l’aspect intrinsèque de la crise du capitalisme n’est pas un sujet spécifiquement européen, cela me pousse au troisième point, qui est la crise de notre mode de développement, qui n’est pas non plus un sujet spécifiquement européen.
Considérant ces trois aspects, le niveau européen est-il vraiment pertinent ? Je ne dis évidemment pas qu’il ne faut rien faire en Europe, mais est-ce réellement le niveau pertinent ? La réflexion que je fais est très théorique et elle est hélas pratiquement inopérante. Mais le bon niveau serait objectivement celui du G20, où Il y a non seulement les pays historiquement développés, notamment européens, mais aussi des émergents y sont représentés comme la Chine, la Russie, l’Inde, le Brésil, etc. Sauf que le G20 est une marque d’impuissance. Objectivement, s’il devait y avoir demain un lieu de régulation, à défaut d’être mondial mais à tout le moins multilatéral et international, le G20 serait probablement le cadre adéquat pour traiter à la fois de la régulation et de la durabilité. Mais je reconnais qu’actuellement c’est hélas totalement illusoire ; car le dernier Sommet du G20 à Hambourg a une nouvelle fois montré que ce genre de réunion n’est pas loin d’être une perte de temps.
La deuxième chose que je voudrais dire, c’est qu’on a, au niveau de l’Europe, trois modèles d’approche et de règlement des problèmes. Au fond, les problèmes ne sont pas en eux-mêmes très différents d’un pays à l’autre. Les diagnostics ne sont pas forcément non plus très différents. Ce qui est différent, c’est la manière dont les problèmes sont résolus. Il y a globalement trois modèles de règlement des problèmes en Europe, qui ne sont pas en voie de convergence.
Le modèle allemand, autrichien, hollandais, scandinave est un modèle collégial, c’est-à-dire que les acteurs sociaux règlent leurs problèmes (leurs conflits d’intérêts notamment) entre eux et de façon collégiale. L’autre modèle de règlement des problèmes est le modèle conflictuel, français ou italien par exemple. Les problèmes sont réglés dans l’affrontement des parties, avec une forte implication des pouvoirs publics. Le 5 décembre 2019 en est la preuve vivante. Le troisième mode est celui des pays d’Europe centrale, qui est un modèle autoritaire. C’est ce qu’on appelle les démocraties illibérales. Le parti au pouvoir en Pologne décide de tout, de même en Hongrie. A mes yeux, en Europe, aujourd’hui, nous sommes plus loin qu’il y a 15 ans d’avoir une harmonisation sur la façon de régler les problèmes. C’est un vrai obstacle au bon fonctionnement de l’Europe.
Le troisième point concerne ce que vous avez évoqué sur les entreprises, qui me paraît absolument essentiel. Il y a quatre tendances lourdes dans les entreprises depuis vingt ans. La première tendance lourde est la rentabilité fortement accrue du capital, qui s’explique pour partie par une augmentation des salaires moins rapide que celle de la productivité, ce qui a provoqué une baisse des salaires dans la part de la valeur ajoutée dans tous les pays – dix points de moins par rapport à il y a quinze ans. Vous avez en second lieu une baisse de la fiscalité des entreprises de façon générale en Europe. Objectivement, les entreprises, quel que soit le pays, le secteur, leur taille, sont beaucoup plus rentables que ce qu’elles l’étaient il y a vingt ans. La rentabilité du capital aujourd’hui –je travaille pour plusieurs fonds d’investissement en France et en Allemagne- est aujourd’hui historiquement très élevée. Il y a, par rapport à cette rentabilité du capital, quelque chose qui va en sens contraire pour les entreprises – et c’est mon troisième point -qui est une augmentation des incertitudes. Les entreprises ont des contraintes qui sont en grande partie nouvelles et qui encadrent et limitent leur liberté en tant qu’opérateurs: des contraintes environnementales qui se sont énormément développées et sont des facteurs limitatifs de la liberté des entreprises. Elles sont vécues comme des contraintes par les entreprises, telles que l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, l’amélioration des conditions de travail, etc. Tous ces facteurs-là sont des facteurs qui ont abouti à une augmentation de l’incertitude, car il y a tous les jours des nouvelles réglementations européennes, voire nationales qui encadrent l’activité des entreprises.
Il y a un dernier point très important, qui est d’ailleurs, pour l’instant tout au moins, beaucoup plus marqué en Allemagne qu’en France : vous avez une pression sociétale croissante sur les entreprises concernant de multiples sujets sensibles, comme par exemple l’environnement, le développement durable, le commerce équitable, l’éthique des affaires, ce qui pose la question de ce qu’a formulé le patron de Volkswagen en une phrase : licence to operate. Cette question de la légitimité va devenir un problème crucial. Je pense que ce qui va poser le plus de problèmes aux entreprises dans les prochaines années ne sera probablement pas la fiscalité, mais le fait qu’elles vont avoir à faire de plus en plus à des clients qui ont des comportements de citoyens et pas simplement des comportements de purs consommateurs, et qui sont imprévisibles car ils ne sont pas organisés dans des corps intermédiaires.
Par exemple, en Allemagne, ce problème est devenu central pour les constructeurs automobiles dans leur développement produit, car ils ne savent pas ce que va devenir leur vache à lait, à savoir les véhicules SUV. Angela Merkel avait pour objectif en 2020 un million de véhicules électriques vendus en Allemagne. En 2020, il n’y aura pas un million de véhicules électriques, mais un million de SUV vendus en Allemagne. Sauf que la génération de mes enfants rejette les SUV. Les gens qui se baladent en Porsche Cayenne sont devenus en Allemagne des asociaux. Ce qui est légitime pour une entreprise de faire et de vendre et ce qui ne l’est pas va devenir un problème central pour elles. Cela touche tous les secteurs, la finance par exemple avec les comportements de certaines banques dans des paradis fiscaux. Cette question du licence to operate est une question qui va devenir cruciale pour les entreprises, du fait de son caractère imprévisible. Rien ne gêne plus un chef d’entreprise que l’absence de visibilité, car pour prendre un risque, faire un investissement, il faut quand même avoir des paramètres contrôlables. Par exemple, en Allemagne, un gros tiers des gens disent vouloir interdire les vols intérieurs et vouloir uniquement se déplacer en train. Il y a donc 35% des allemands qui pensent qu’il faut interdire les vols intérieurs, or c’est la licence to operate de la Lufthansa qui est ici en jeu et c’est un vrai problème, quasiment de survie, pour cette entreprise. Ce sujet de la licence to operate me paraît être un défi majeur.
- Mireille BATTUT (modératrice), membre du Conseil d’Administration de Confrontations Europe
On a vu à quel point les imaginaires et les représentations peuvent différer. Pour autant, le rôle du politique, c’est de trouver des lieux où ces différents imaginaires peuvent se confronter, où on peut faire des arbitrages entre différent intérêts. Je vais m’adresser à Laurent Berger pour lui poser la question de sa vision du caractère protecteur ou non de l’Union européenne. En ayant en tête notamment que l’UE c’est d’abord la circulation économique, la liberté d’entreprendre, mais c’est aussi une construction du dialogue social. C’est aussi des lieux où des représentants de différente culture apprennent à se confronter.
- Laurent BERGER, Président de la Confédération Européenne des Syndicats
Cette discussion est extrêmement intéressante : parfois, un certain nombre d’acteurs se réfugient derrière le mot crise pour dire qu’il n’y a plus rien à faire, ce qui nous distingue d’ailleurs en France de nos camarades nordiques ou autres. Ce qu’il faut, c’est imposer au capital davantage de régulation. C’est ça la voie qu’il faut suivre. La régulation s’opère y compris par une participation accrue des travailleurs et la reconnaissance de leur apport indispensable à la création de richesse.
L’Europe, c’est un modèle social. Je sais que c’est dur de le dire et on ne peut pas le dire partout, mais l’Europe c’est un modèle social. Il suffit d’aller à la rencontre, dans le cadre de la Confédération syndicale internationale, de nos collègues d’autres continents pour s’en convaincre. C’est un modèle social dans le verbe. Dans le traité de Lisbonne, on fait appel à un certain nombre de valeurs qu’on érige, y compris le respect des droits de l’Homme, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’état de droit, etc. Il y a la place du social dans les traités et il y a également le socle européen des droits sociaux. On ne peut pas dire que dans le verbe, l’Europe ait complètement mis de côté la question sociale. D’ailleurs ce constat fait parfois l’objet de débat entre syndicalistes européens et il est parfois contesté. A partir d’une vision erronée de la réalité, on n’agit pas comme il faut. La réalité, c’est que, dans le verbe, il y a une affirmation sociale de l’Europe. On peut parler de l’inscription du social dans un certain nombre de production de normes, du rôle des partenaires sociaux dans la production de normes, etc. Mais, d’une part, ce n’est pas du tout perceptible. Et, d’autre part, c’est inégalitaire selon les territoires en Europe. Enfin, on n’est pas passé de la parole aux actes dans beaucoup de domaines. L’enjeu de demain, clairement, qui est aussi un enjeu géostratégique pour l’Europe, c’est d’avoir la capacité de conjuguer la nécessaire transition écologique avec de la justice sociale.
Cela nécessite au moins trois éléments très forts : cela nécessite tout d’abord d’avoir une vraie volonté politique. On la vérifiera la semaine prochaine quand on la rencontrera, mais on ne peut pas dire que la nouvelle présidente de la Commission européenne n’affirme pas ça comme une vraie volonté. Le seul problème, c’est qu’il faut que Monsieur Schmitt [Commissaire européen à l’emploi et aux droits sociaux] et Monsieur Timmermans [Vice-Président Exécutif de la Commission en charge du Pacte Vert pour l’Europe] travaillent réellement ensemble, et d’autres encore. Il faudra également qu’il y ait vraiment de la transversalité sur la question financière et économique. Car, tout cela nécessite de l’investissement. La Confédération européenne des syndicats avait salué le plan Juncker mais quand on regarde aujourd’hui, ça a été plutôt pour soutenir des politiques nationales que des politiques européennes. Je ne dis pas que ce sont des choses contradictoires, mais ce dont il est question, c’est vraiment d’engager l’Europe vers cette transition écologique et les éléments de progrès social dans un cadre avec une vision européenne. Ça c’est le premier plan. Je pense que le rôle de la finance est déterminant sur cette question-là. Pour des syndicalistes, si on s’en désintéresse, on va dans le mur. Ce posera aussi la question de la règle des 3%. Je suis persuadé, et c’est une vision qu’on porte avec l’ensemble de la société civile, qu’il faut pouvoir s’exonérer de cette règle pour certains investissements.
Il faut que l’Europe soit en capacité d’impulser et de contraindre. Je pense que l’Europe doit impulser auprès des acteurs et en direction des entreprises et doit avoir une forme de contrainte. Sinon, ce qui est perçu par les travailleurs c’est que la contrainte est pour eux et que la liberté est pour les entreprises. C’est caricatural et en partie faux, mais quand quelque chose est ressenti à ce point, on a un problème. Cette capacité de conjuguer deux types d’action est extrêmement importante. Et cela fait débat au sein du syndicalisme européen. Ça c’est le deuxième point : impulser et contraindre.
Le dernier élément qui me paraît fondamental, c’est de faire avec, c’est la co-construction. On reviendra sur la question des entreprises. Il faut responsabiliser les entreprises. Et, on les responsabilise si on reconnait la partie constituante que sont les travailleurs en leur sein et qu’on associe les représentants des travailleurs à la gouvernance de l’entreprise et pas seulement pour les questions sociales mais aussi pour les questions stratégiques. Par exemple, au niveau français, pour aller d’une logique de conflit permanent vers une logique de conflictualité positive qui fait émerger des solutions, cela me paraît déterminant. Cela veut dire qu’il faut remettre la question du dialogue social au niveau européen, pas simplement au niveau de la Commission européenne, mais aussi au niveau sectoriel, au niveau du dialogue européen au sein des multinationales. Cela dépendra du comportement des acteurs. On a une négociation sur la digitalisation actuellement : si Business Europe n’a pas la capacité d’être plus moderne et ouvert sur les impacts que cela peut avoir et sur les nouvelles formes de travail, mais aussi sur la façon dont peut s’exercer le travail des salariés, sur l’évolution d’un certain nombre de métiers qui sont amenés à disparaître, à évoluer, et la nécessaire anticipation, on n’y arrivera pas. L’Europe ne peut s’en sortir que si elle régule son capitalisme et elle ne peut pas faire toute seule. Le seul problème, c’est que ça n’a pas marché et ça ne marchera pas durablement au sein du G20. Il faut qu’on trouve une solution. Il faut, chez nous, être capable de faire monter les standards sociaux et d’aller vers une forme d’harmonisation, d’être capable d’avoir les vrais fonds de transition. Car cela va être extrêmement brutal dans un certain nombre de secteurs, notamment dans le cadre de la transition écologique. Il faut que l’Europe revivifie sa démocratie.
Le seul problème du point de vue des travailleurs, c’est que l’Europe est le point aveugle. Je rebondis sur l’allusion de Jean-Jacques Barbéris : On est quand même en train de se battre dans notre pays sur ce qui va se passer dans une quinzaine d’années sur la question des retraites, quand le rapport de l’ONU la semaine dernière a dit que si on n’agit pas très concrètement sur la transition écologique dans la dizaine d’années à venir, la question des retraites de nos enfants sera assez subalterne. Le vrai sujet pour l’Europe d’un point de vue économique, social et environnemental c’est de regarder à moyen et à long terme pour échapper à la dictature du court-terme dont les conséquences sont, y compris au niveau européen, assez dramatiques.
- Mireille BATTUT (modératrice), membre du Conseil d’Administration de Confrontations Europe
Monsieur Wahl, je vous propose à la fois de répondre à la première question mais aussi d’amorcer la deuxième question que nous envisageons, à savoir le rôle de l’entreprise et de ses parties prenantes. Cela nous permettra d’avancer en prenant en compte tout ce qui s’est dit. En tant que dirigeant d’entreprise et de surcroît implanté sur des territoires, comment voyez-vous le rôle des différentes parties prenantes de l’entreprise, le rôle de l’entreprise ?
- Philippe WAHL, Président-directeur général du Groupe La Poste
En tant qu’entreprise, Il faut considérer le monde dans lequel nous vivons. Ce que j’observe, ce sont deux faits : la première chose, c’est que le modèle capitaliste s’est étendu sur la quasi-totalité de la planète. A part Cuba et la Corée du Nord, tous les autres pays vivent avec une économie de marché et un système capitaliste plus ou moins intégré. On note d’ailleurs que cette extension ne s’est pas accompagnée, comme les théoriciens américains libéraux le pensaient, de la démocratie libérale. On peut avoir un capitalisme efficace avec un Etat autoritaire. Le capitalisme s’est étendu ; il a donc, d’une certaine façon, gagné.
Le deuxième point qui me paraît clair, c’est sa crise : il est en train d’épuiser la planète. Peu importe qu’on le qualifie, qu’on le perçoive de crise ou pas, mais la planète est en train de disparaitre dans ses capacités de soutien de la vie humaine parce que l’activité humaine est en train de dévorer la planète. C’est ça la crise. Le modèle actuel du capitalisme est-il soutenable par la planète ? Cette question-là est clef. C’est ce que nous disent les nouvelles générations, les rapports de l’ONU : le modèle économique actuel n’est plus soutenable par la planète en termes de ressources, et donc pour l’Humanité qui y vit. Ça doit nous conduire avant même la question climatique à penser un nouveau capitalisme. La question de ce nouveau modèle me paraît être la question première. On parle d’Europe puissante, d’Europe souveraine… c’est vrai, mais pour quel modèle ? La transition écologique, pour quel modèle ? Quel modèle non seulement pour nous sociétés européennes, mais pour la totalité de l’Humanité ? Est-ce que les Asiatiques, les Américains, les Latins et les Africains ont besoin d’un nouveau modèle et qu’est-ce que nous proposons comme solution en raison de la tradition universaliste qui est celle de l’humanisme européen ? C’est donc bien la reconstruction d’un modèle dont il faut parler. C’est un défi théorique pour les chercheurs. J’ai entendu le responsable de la CFE-CGC dire qu’il fallait un grand plan d’investissement d’infrastructures d’énergie. Je suis d’accord, cela va créer des emplois, de la richesse, mais pour quel modèle ? Est-ce pour mieux consommer les ressources de la planète ou pour changer de modèle ? Je pense donc que nous sommes confrontés globalement, au-delà de la transition écologique, à la question du modèle vers lequel nous voulons aller.
Je ne suis pas certain que les entreprises sauveront la planète. Il me semble que les régulations devraient déjà empêcher des entreprises de le détruire. Les entreprises peuvent contribuer, à leur place, à sauver le monde. Il s’agirait déjà d’agir sur les dégâts du progrès. L’entreprise est duale : elle créée de la richesse mais elle peut créer de l’aliénation et créer de la destruction des ressources. Les entreprises ne sauveront pas seules la planète et elles peuvent y contribuer dans le cadre de la régulation du capitalisme. Le capitalisme qui peut réussir à être compatible avec la planète et la cohésion sociale est un capitalisme régulé. C’est un capitalisme dans le cadre duquel on ne demande pas aux chefs d’entreprises de définir leurs propres règles. Dans la finance, jusqu’à la crise, il y avait l’autorégulation. Or, quand vous êtes chef d’entreprise, votre devoir c’est de développer l’entreprise, de faire des investissements, donc de gagner de l’argent. Si on vous demande en même temps de vous limiter, vous installez la schizophrénie à l’intérieur de chaque chef d’entreprise. La recherche de la maximisation du profit risque de l’emporter. Les entreprises doivent se voir à leur place, extrêmement puissantes, mais uniquement à leur place. C’est une action de co-construction qui permettra de changer le modèle.
La prise en compte des parties prenantes est l’une des réponses. Ce qui s’ouvre à travers cet épuisement du modèle actuel du capitalisme, c’est une demande de démocratie dans l’entreprise. Le patron doit être capable de faire émerger l’intérêt supérieur de son entreprise. Mais le fait que les parties prenantes n’élisent pas eux-mêmes leur patron n’interdit pas de leur faire jouer un plus grand rôle dans l’entreprise. Ceci me paraît indispensable et en plus, efficace
Pour parler de choses concrètes, que faisons-nous à La Poste ? Nous sommes 250 000 ; l’idée de transformer une entreprise menacée – puisque la lettre qui est notre raison d’être est en attrition – sans avoir l’énergie et la participation de sa force de travail est vouée à l’échec. La Poste se transformera, par et avec les postiers. Depuis 6 ans que j’en suis le PDG – et il n’y a pas de cause à effet entre les deux faits, La Poste a perdu 3,6 milliards d’euros de chiffre d’affaire à cause de la baisse du courrier. D’ici 2025, nous allons encore perdre 2 milliards d’euros de chiffre d’affaire. La transformation nécessaire et complexe n’a de chances de réussir que si les salariés en sont les acteurs et aussi les bénéficiaires. Je suis favorable à la co-construction dans la définition du bien commun. Et notre entreprise ne peut se transformer que par la co-construction.
- Mireille BATTUT (modératrice), membre du Conseil d’Administration de Confrontations Europe
Je vais donc proposer un deuxième tour de question : quel est le rôle de l’entreprise, celui de ses parties prenantes et celui de la puissance publique dans cette « grande transformation » ?
- Pervenche BERES, députée européenne de 1994 à 2019
Sur le capitalisme, il faut le redire car on ne peut pas conclure en pensant qu’il suffit de réformer le capitalisme pour qu’il nous sauve. Il y a des capitalismes qui sont compatibles avec des dictatures, ça a été dit. Le sujet, c’est comment reconstruit-on dans le cadre d’un capitalisme raisonnable ou supportable, c’est-à-dire comment reconstruit-on des contrepouvoirs ? Je parle comme responsable politique évidemment. On a évoqué les social-démocraties dans la précédente table-ronde. Depuis la deuxième guerre mondiale, la question du contrepoids de la social-démocratie a joué un certain rôle. L’effondrement de la social-démocratie avec la mutation du capitalisme a, au fond, surpris tout le monde, et tout le monde a été dépassé par la financiarisation de l’économie. La première grande victime de cette mutation est la social-démocratie, qui n’a pas osé après la chute du Mur dire ce qu’elle avait à dire et penser qu’elle devrait repenser les choses. La financiarisation de l’économie c’est aussi la suppression des outils de redistribution et donc du contre-pouvoir d’un capitalisme débordant.
Face à ça, que fait-on ? On traite en parallèle la question transition écologique et la question sociale. Il faut associer comme partie prenante les salariés, il faut relancer la question du SMIC. Une chose qu’on n’a pas évoqué ce matin et je veux apporter un élément dans la conclusion : c’est que le salarié reste majoritaire dans ce pays et en Europe. Mais la question de savoir quel est le statut de ceux qui travaillent sur les plateformes numériques est critique. Je vois que la France a envoyé à Bruxelles un Commissaire européen pour pousser un agenda très offensif, compatible avec les ambitions du patronat français ; s’il le fait sans tenir compte de la nouvelle équation, de la négociation sociale, de l’expression de la revendication sociale sur les plateformes, ça ne marchera pas. Je vous invite à regarder un rapport que j’ai piloté pour le réseau social du parti socialiste européen sur ce qu’est la question sociale à l’heure des plateformes numérique. Très concrètement, ma contribution aujourd’hui, c’est le travail auquel je suis associée à l’Autorité des Marchés Financiers dans le cadre de cette commission climat et finance durable, dans lequel se pose la question du label, de la comptabilité. C’est aussi vieux que tous nos débats, mais on ne peut plus continuer que ce soit au niveau micro ou macro avec des indicateurs qui sont d’abord le Produit National Brut et le Chiffre d’Affaires. Il faut d’abord avoir d’autres indicateurs et je peux vous dire que ce n’est pas une mince affaire. Quelle est la méthodologie ? Est-ce un champ volontaire ou un champ strict ? C’est un débat très compliqué mais en même temps très politique et tout à fait essentiel. Cette équation entre l’entreprise, le social, la transition écologique et la démocratie est notre responsabilité. C’est à nous de le faire. Il nous faut également prendre le leadership pour être ceux qui inventent cette taxonomie et ce label européen comme un indicateur et une contribution à cette nouvelle direction.
- Patrice PELISSIER, Ancien président du directoire de MEA AG, Consultant .
Je voudrais juste rebondir sur ce que Laurent Berger a dit. Je pense qu’il faut bien être conscient, comme vous l’avez souligné, que le capitalisme financier est surdéterminant et qu’il est quelque chose de très différent du capitalisme industriel. Dans le capitalisme industriel, vous pouvez certes opérer des délocalisations et des changements structurels dans votre chaîne de valeur ajoutée, mais c’est quand même un type de capitalisme qui est sujet à encadrement, à régulation. Dans le secteur financier, c’est beaucoup plus compliqué. Il n’y a rien qui soit plus mobile que l’argent et les actifs financiers. On peut déplasser en une fraction de seconde des dizaines de milliards de dollars avec un clic de souris. Le problème n’est pas celui de définir des règles d’encadrement. Le problème est l’incroyable créativité et la capacité exceptionnelle des acteurs opérant sur le marché des capitaux à se soustraire à ces règles. C’est beaucoup moins le cas dans le secteur industriel, car vous ne pouvez pas constamment déplacer des usines du jour au lendemain. Par contre, on peut très bien déplacer les capitaux investis en une fraction de seconde quand on est gestionnaire de fonds d’investissements, pour les localiser dans des pays plus acceuillants que l’UE.
Tout cela est bien connu. Les deux derniers rapports de la Banque des Règlements Internationaux pointe le développement du shadow banking , depuis que l’Union européenne a mis en place des mécanismes de contrôle et de régulation. Leur lecture est absolument effrayante : les règles sont bonnes, mais les investisseurs financiers peuvent s’y soustraire, en tout cas bien plus facilement qu’un industriel à qui on impose de diminuer ses émissions toxiques.
- Jean-Jacques BARBERIS, Membre qualifié, Finance for Tomorrow
Fondamentalement, ce n’est pas uniquement une question de régulation. C’est la manière dont on compte. A partir du moment où vous intégrez et où les acteurs financiers sont forcés d’intégrer des éléments qui sont extra-financiers dans la manière dont ils valorisent, vous changerez les choses. Je vais vous faire en la démonstration très simplement.
Aujourd’hui, une action d’une entreprise qui a un meilleur profil ESG en Europe vaut plus cher qu’une action d’entreprise dans le même secteur qui a un moins bon score. Cela signifie que le coût du capital pour une entreprise qui, d’un point de vue ESG, est moins performante est plus élevé. C’est un changement fondamental dans la manière dont on compte et dont on valorise. A la fin de la journée, le cours d’une action est le même partout dans le monde. C’est de cette manière-là qu’on pourra agir. Il y a un rôle très important pour le Green Deal européen et dans le projet de taxonomie qui doit fonctionner intelligemment et qui ne doit pas dire que le nucléaire c’est mal. Quand on change fondamentalement la manière dont on compte et on valorise, à ce moment-là, vous changez fondamentalement le cœur du système.
- Philippe WAHL, Président-directeur général du Groupe La Poste
Par exemple, dans le groupe la Poste, il y a une banque. Nous en faisons un argument de différenciation. La Banque Postale gestion d’actifs dit qu’en 2020, elle sera 100% ISR, c’est-à-dire investissement socialement responsable. Le discours sous-jacent : plutôt que la plainte sur les désordres climatiques : vous avez de l’argent à investir, nous vous proposons des investissements qui seront 100% ISR. Cela peut avoir un effet au fur et à mesure sur les flux d’argent sur la planète.
- Laurent Berger, Président de la Confédération Européenne des Syndicats
Finalement, ce qui se joue au niveau européen, si on veut prôner un modèle beaucoup plus vertueux socialement et économiquement, c’est jouer la technique de l’encerclement. La question du rôle de la finance est absolument déterminante. La question de la participation des citoyens et des travailleurs dans l’entreprise est absolument déterminante. La question de la RSE à l’égard de leurs sous-traitants et l’idée qu’on puisse progresser au niveau européen sur la question de la vigilance comme on a essayé de le faire au niveau national est absolument déterminante. La question de l’accompagnement des transitions – car personne ne peut croire que cela va se passer tranquillement – est absolument déterminante.
L’autre aspect déterminant est de considérer que l’Europe ne s’arrête pas quand on passe la frontière. Je le dis car le verbe est là et que c’est compliqué mais ce n’est pas la faute de la Commission européenne. Certes, on a traversé pendant 10 ans le désert puis on a eu un peu de renaissance mais cela reste assez compliqué et il faut aller vite, or l’Europe ne va pas vite par essence. Au niveau syndical, ce n’est pas la CES qui bloque. Ce qui bloque, c’est que quand les organisations nationales sont rentrées chez elles, elles voient les choses différemment. Il faut aussi travailler sur la société civile et sur les citoyens. Les européens que nous sommes dans cette salle et un peu plus largement, c’est là où nous péchons. Il faut poser une théorie sur le monde, je crois même qu’il faut reconstruire de l’intellect autour du modèle de développement et de l’idée de progrès qu’on veut créer, mais la capacité d’entraînement est préoccupante.