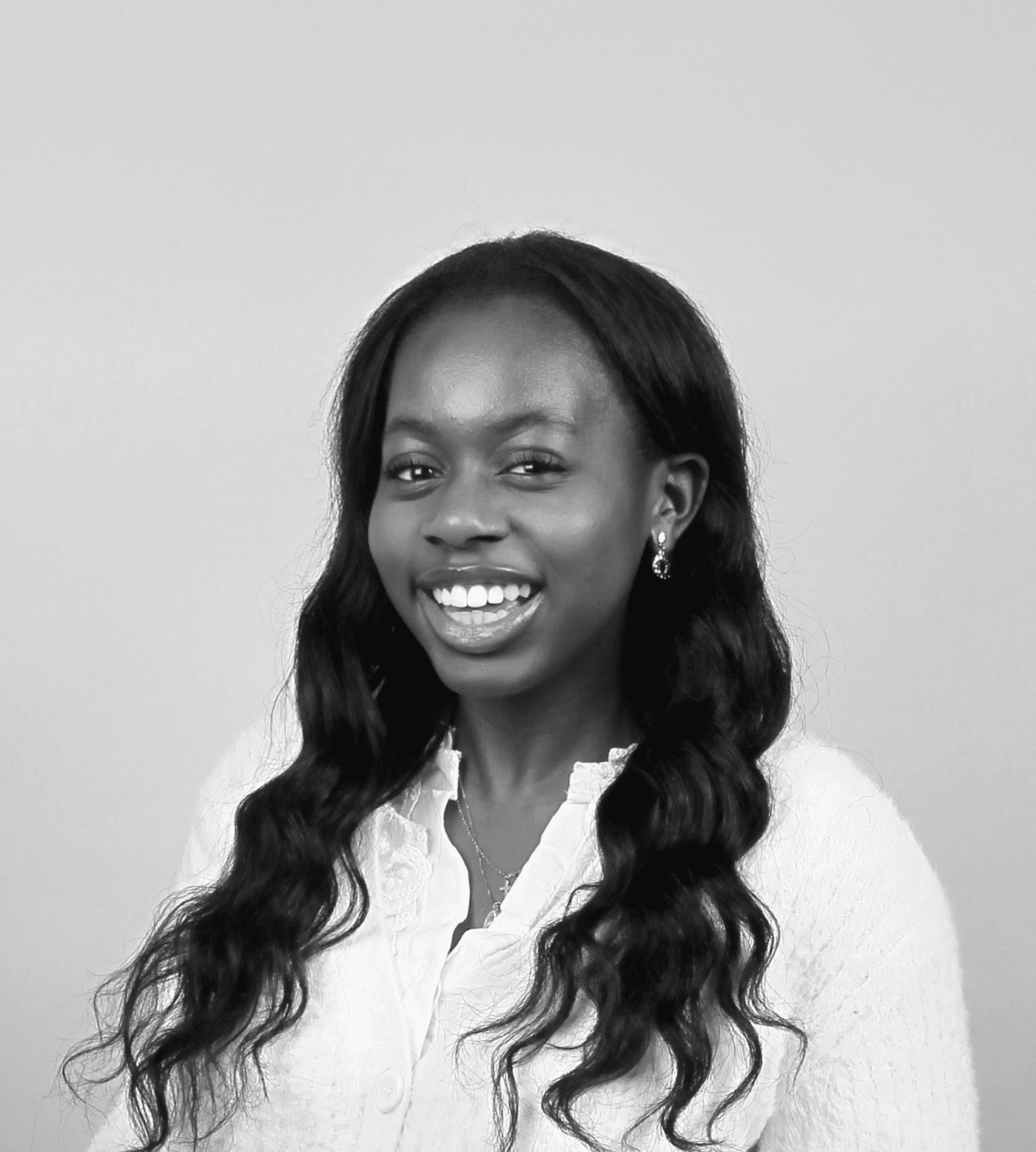Auteur : Mario Telo’ Professeur de sciences politiques et de relations internationales à la LUISS (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali) à Rome et à l’Université libre de Bruxelles (ULB), et président émérite de l’Institut d’Études européennes L’Union européenne est encore bien trop souvent décrite comme affaiblie par les multiples crises auxquelles elle doit faire face. Pourtant, comme le rappelle le politologue Mario Telo’, à l’heure où une nouvelle Commission entre en fonction, les institutions européennes ont démontré leur grande force. On n’a pas assez souligné le fait qu’entre les élections européennes de mai, les nominations du mois de juillet et la formation de la nouvelle Commission en septembre, on a assisté à une démonstration évidente de la force des institutions européennes. Alors que prévaut un du pessimisme radical, que le conformisme des médias et des intellectuels fait qu’on ne peut plus parler de l’Union européenne sans employer les mots
Ce contenu est réservé aux abonné(e)s. Vous souhaitez vous abonner ? Merci de cliquer sur le lien ci-après -> S'abonner