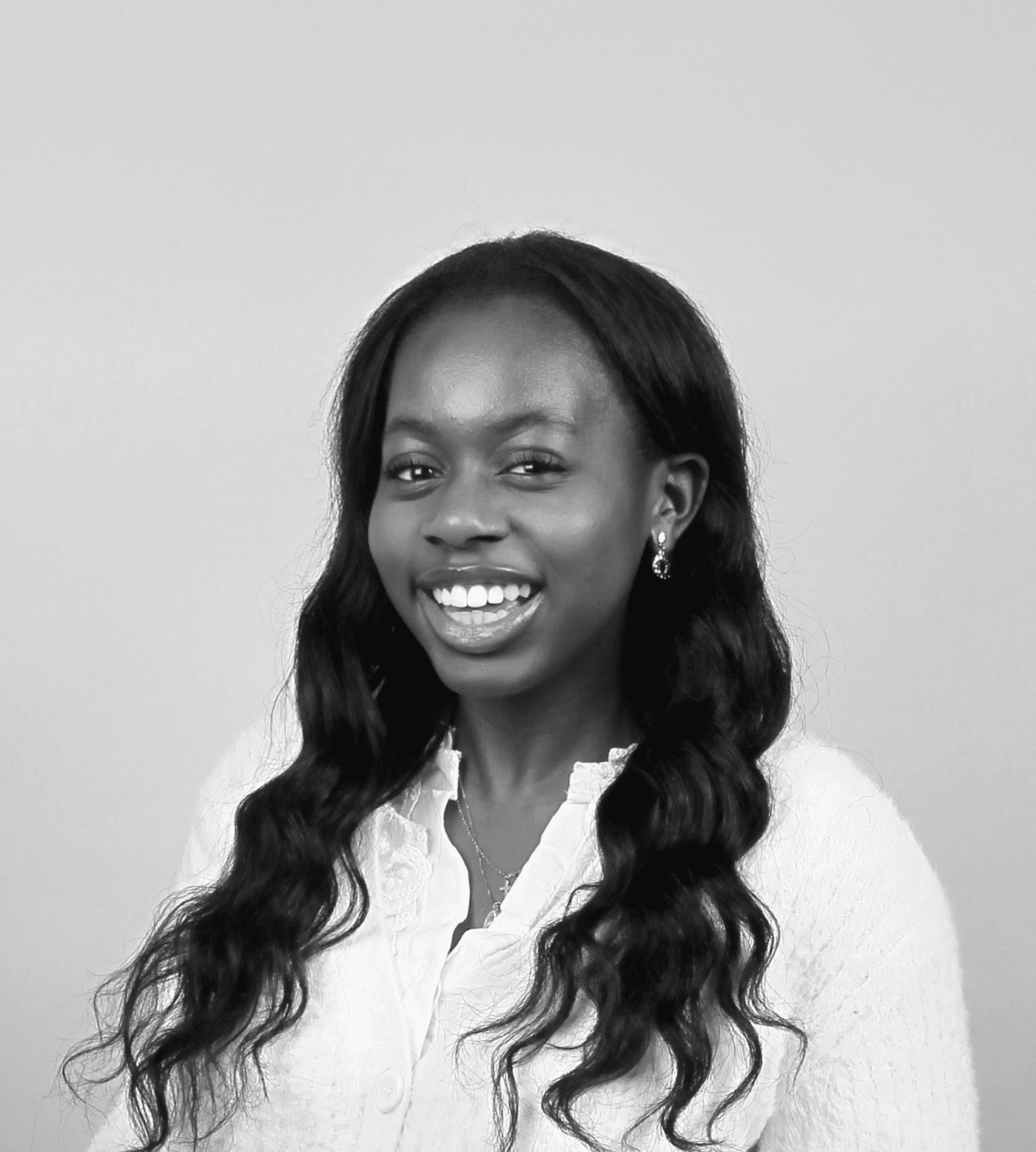Auteur : Patrick Boucheron historien, Professeur au Collège de France, titulaire de la Chaire « Histoire des pouvoirs en Europe occidentale (xiiie-xvie siècles) [vc_btn title= »Télécharger l’article » style= »outline » color= »default » align= »right » i_icon_fontawesome= »fa fa-file-pdf-o » add_icon= »true » link= »url:http%3A%2F%2Fconfrontations.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F09%2FConfrontations-Europe-La-Revue-n%C2%B0126-P28-29.pdf||target:%20_blank| »] Une certaine idée de l’Europe, c’est le titre de l’ouvrage qui rassemble les allocutions de cinq penseurs invités par la revue le Grand Continent à évoquer leur idée d’Europe(1). Loin des ouvrages d’hommes politiques à la fois ancrés dans un présent immédiat et réducteurs, loin d’un discours médiatique forcément trop rapide, les historiens Patrick Boucheron et Elisabeth Roudinesco, le sociologue Antonio Negri, l’économiste Thomas Piketty et la philosophe Myriam Revault d’Allonnes ont ainsi ouvert les voies d’une Europe idéale, pleinement politique. Confrontations Europe est heureux de livrer un extrait de l’allocution de Patrick Boucheron publiée sous le titre Ce qui a manqué à l’Europe. Les mélancoliques n’ont pas toujours tort : on est fondé à se désoler de cette
Ce contenu est réservé aux abonné(e)s. Vous souhaitez vous abonner ? Merci de cliquer sur le lien ci-après -> S'abonner