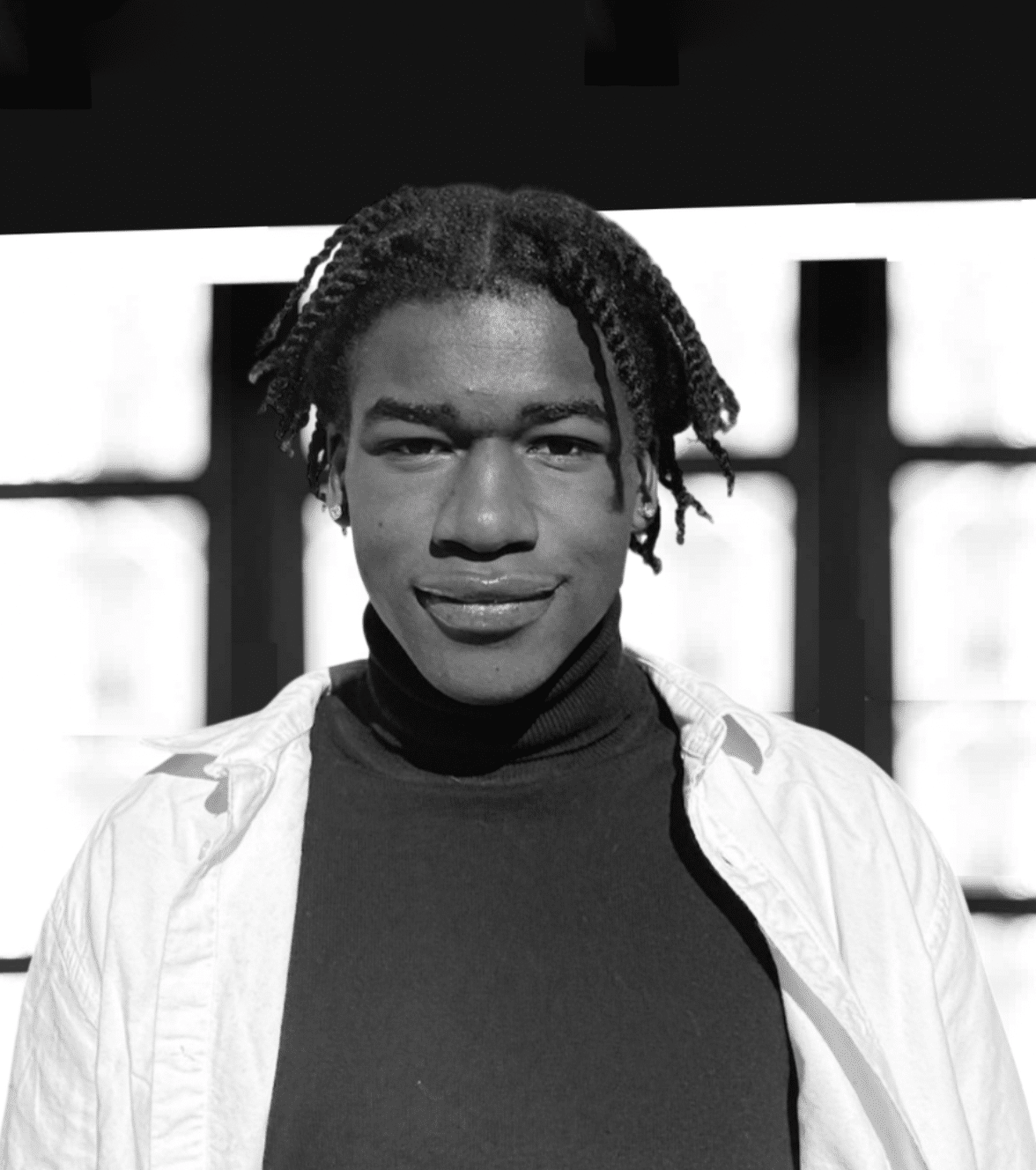Par Olivier de France, Directeur de recherche à l’IRIS (Institut de Relations Internationales et Stratégiques à Paris) – LA REVUE #136. L’histoire est passée à la postérité. Suite à d’interminables fouilles entamées en 1868 pour mettre au jour la mythique cité de Troie, l’artefact principal qu’un architecte amateur du nom d’Heinrich Schliemann finira par découvrir sous le mont turc d’Hissarlik est… un mur fortifié. Quelque quatre millénaires après l’érection de la fortification d’Hissarlik, le quarante-cinquième président des États-Unis brandissait l’ordre exécutif 13767 devant les caméras massées dans le bureau ovale. Il ordonnait à son gouvernement d’ériger en janvier 2017 un mur de huit cents kilomètres entre les États-Unis et le Mexique[1]. A quelques brefs millénaires d’intervalle, ces exemples semblent faire affleurer l’un des invariants apparents de l’histoire humaine. L’existence même d’une communauté politique n’a-t-elle pas, après tout, toujours reposé sur la distinction qu’elle opère entre elle-même et l’extérieur ? Sur un
Ce contenu est réservé aux abonné(e)s. Vous souhaitez vous abonner ? Merci de cliquer sur le lien ci-après -> S'abonner