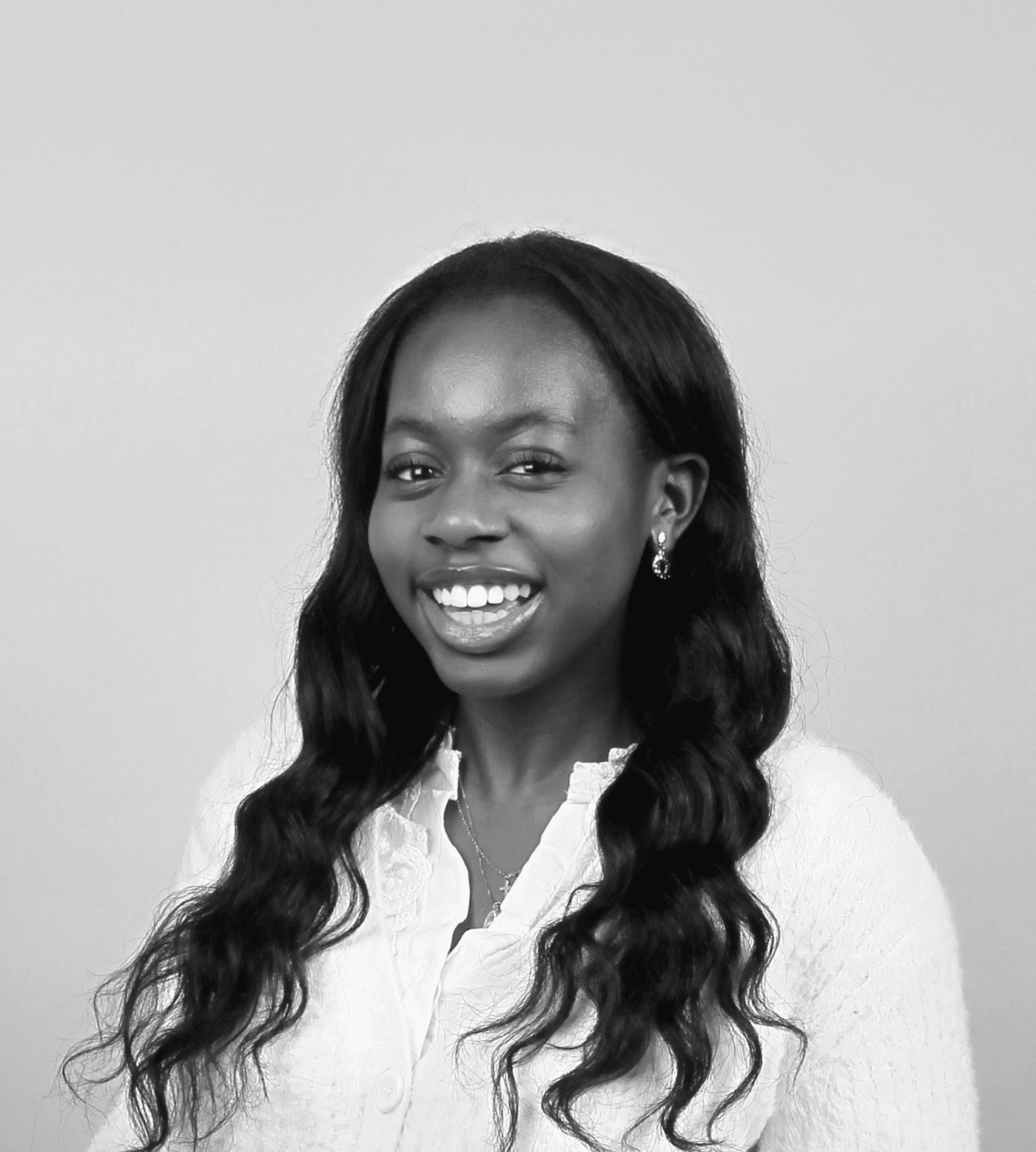Confrontations Europe a eu le plaisir de rencontrer Michala Marcussen, Chef économiste du groupe Société Générale et Directrice des études économiques et sectorielles. L’économiste danoise dispose de plus de trente-cinq ans d’expérience de recherche économique dans le secteur bancaire, en particulier au sein du groupe Société Générale, où elle a notamment été Responsable de la Recherche de Société Générale Asset Management (SGAM) et Chef économiste de la banque d’investissement (SG CIB). Son point de vue sur la conjoncture mondiale, l’économie américaine, l’ascension de la Chine et les modalités des réformes européennes est retranscrit dans cet entretien mené par Olivier Marty, Conseiller économique et financier, et Corinne Cherqui, Secrétaire générale, le 1er décembre.
Confrontations Europe (C.E.) : Débutons cet entretien en abordant brièvement la conjoncture mondiale. Dans une récente publication pour la Revue Banque, vous rappelez que les incertitudes mondiales dépriment l’activité, tout en pointant qu’elles peuvent aussi avoir des effets positifs à court terme. Pouvez-vous revenir sur cet enchaînement d’idées ?
Michala Marcussen (M.M.). : Les incertitudes, qu’elles soient géopolitiques, liées à la politique commerciale ou à la politique intérieure, ou simplement propres à des facteurs spécifiques (e.g. climat, flux de capitaux) sont en effet, d’abord, négatives. Cependant, dans ce papier, j’ai voulu rappeler que l’incertitude pouvait également avoir des impacts positifs sur le PIB à court terme. On l’observe typiquement avec les comportements anticipés de « hoarding » (de stockage, NDLR) des entreprises, ou encore, dans les comptes nationaux, lorsqu’il y a des rebonds des exports ou des pics de recettes fiscales, suivis ensuite généralement de reflux. Enfin, l’incertitude peut aussi être un puissant catalyseur pour des réformes nécessaires, voire urgentes, notamment en Europe. Dans un monde où rien ne change, la nécessité de se transformer est moins urgente et l’on peut aisément repousser les problématiques. Dans un monde d’incertitudes, c’est l’inverse. L’exemple de l’énergie en est une illustration très concrète. C’est l’incertitude liée à son approvisionnement qui a poussé l’Europe à revoir sérieusement sa stratégie pour réduire ses dépendances et diversifier ses partenariats commerciaux. Sans réaction, l’incertitude peut se transformer en fragmentation…
C.E. : Et cette fragmentation, que vous pointez comme un défi beaucoup plus lourd, érige des contraintes particulières aux acteurs économiques et en particulier aux responsables de la politique économique…
M.M. : Tout à fait ! Reprenons l’exemple de l’énergie. Si l’Europe ne s’occupe pas de son approvisionnement et de la décarbonation de l’économie qui, dans l’esprit de Mario Draghi vont d’ailleurs de pair, les décideurs subiront les effets néfastes de la volatilité des prix de l’énergie. Un phénomène de fragmentation s’installera alors et la politique économique sera encore plus contrainte. Il est d’ailleurs utile de rappeler que les chocs de fragmentation sont par nature inflationnistes car ils se manifestent par des chocs négatifs du côté de l’offre (e.g. frictions commerciales, de main d’œuvre, de capitaux). Le Covid-19 est un autre formidable exemple des coûts de la fragmentation. Il est donc crucial de bien prendre en compte ce basculement potentiel de l’incertitude à la fragmentation et de réagir à temps, au risque de devoir subir les coûts élevés de la correction de la fragmentation. Dès lors, il est nécessaire que les acteurs économiques s’adaptent rapidement car le contexte des années passées ne se rétablira pas subitement. A titre d’illustration, les droits de douane du premier mandat de Donald Trump ont été conservés par Joe Biden et il y a fort à parier que les droits actuels seront aussi, en partie, durables.
C.E. : Avant de nous tourner vers l’Europe, faisons un détour par la Chine. Ce pays se caractérise par une montée en puissance protéiforme et très intense qui lui permet désormais de concurrencer les économies avancées dans quasiment tous les domaines. Quel regard portez-vous sur sa dynamique récente ?
M.M. : La Chine a en effet une position dominante sur de nombreux produits, qui lui permet d’être très compétitive à l’export, bien au-delà du seul secteur des panneaux solaires d’il y a quelques années ! Cependant, l’enjeu actuel de la Chine est d’organiser une montée en puissance de sa demande intérieure. Elle a conscience de ce défi, même si les politiques domestiques ne vont pas encore assez loin pour assurer cette transformation. Néanmoins, le pays a fait des efforts pour traiter des risques existants dans le domaine immobilier et engager sa transition énergétique, ce qui se matérialise notamment par le grand nombre de voitures électriques en circulation dans les grandes villes chinoises. En Europe, on a l’habitude de dire qu’on est des « leaders » de la transition bas carbone, mais cela ne sera peut-être plus très vrai à l’avenir… Fondamentalement, la transition énergétique est une question de volonté politique, de technologies et de systèmes énergétiques, et ce triptyque donne aujourd’hui un avantage à la Chine. L’Europe a une dernière chance de ne pas être laissée sur le côté. Le même raisonnement vaut pour les nouvelles technologies. La Chine embrasse très vite l’intelligence artificielle. En Europe, on n’est pas encore assez dans l’action sur ce sujet.
C.E. : Cependant, dans quelle mesure l’Union européenne doit-elle se protéger de la Chine ? Le rouleau compresseur de sa montée en gamme est très fort, mais nous avons aussi besoin de la concurrence de ses produits. Où doit-on placer le curseur ?
M.M. : L’Europe doit certes se protéger mais avant tout se transformer. La protection est utile et légitime là où il y a du « dumping » ou de la concurrence déloyale, ce qui est d’ailleurs encadré par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ou dans les textes européens. Mais nous, Européens, devons aussi nous préparer face aux grandes mutations actuelles, c’est-à-dire nous réformer, nous coordonner et investir dans l’avenir. La protection ne règle certainement pas tout et peut même constituer un risque. Concernant l’attitude à adopter vis-à-vis de Pékin, il n’y a aujourd’hui pas d’accord fort entre Européens alors qu’il serait essentiel d’aboutir à une approche coordonnée sur l’équilibre à adopter entre ouverture et protection. De son côté, la Chine ne semble pas disposée à trouver un terrain d’entente avec l’Europe dans le contexte de la guerre commerciale avec les Etats-Unis. Dès lors, il est difficile d’espérer renouer un dialogue avec Pékin, alors que cela parait toujours nécessaire. Nous risquons donc bien d’aller vers des rapports plus frictionnels, même si je pense que la Chine conserve une volonté fondamentale de travailler avec l’Europe.
C.E. : De l’autre côté de l’Atlantique, comment voyez-vous l’économie américaine ?
M.M. : Aux États-Unis, un net ralentissement est en train de se profiler : le marché du travail se dégrade, mais aussi la démographie, ce qui s’ajoute aux préoccupations liées aux pressions contre les institutions. Au-delà des effets négatifs des droits de douane, l’économie américaine est également très dépendante de la bourse. Les valorisations sont actuellement très élevées et s’il y a des phénomènes de surévaluation, ils pourraient durer un certain temps. Indéniablement, l’intelligence artificielle est une transformation très réelle des tissus productifs. C’est dans ce contexte de ralentissement américain que l’Europe doit penser à sa défense, à ses technologies, à sa croissance. Cette nécessité est d’autant plus prégnante que cela va bientôt faire quatre ans que la Russie a envahi l’Ukraine et que notre réaction face à cette réalité reste lente. Je ne parle pas tellement de la réaction politique, avec les trains de sanctions ou le soutien à Kiev, mais plutôt des avancées en matière d’infrastructures énergétiques et de défense militaire, où le rythme de l’Europe est encore trop lent.
C.E. : Comment l’Union européenne peut-elle donc réagir et dépasser son problème de coordination pour mettre en œuvre les réformes qu’elle a bien identifiées, notamment dans le rapport Draghi ? Comment peut-elle, par exemple, approfondir le marché intérieur ou accélérer sa diversification énergétique ?
M.M. : Dans un contexte où l’Europe est bousculée, on ne peut éluder ce problème de coordination mais il faut surtout considérer les deux dimensions de l’action européenne. Il y a la dimension de l’Union, qui peut être facilitée, par exemple par des coopérations renforcées. Mais beaucoup de choses peuvent également être faites au niveau national. Sur la période récente, plusieurs pays du Sud ont mené des réformes avec succès : parmi les grands pays européens, il y a l’Italie et l’Espagne, mais aussi la Grèce ou le Portugal. Ces efforts ont été douloureux, durs, mais ils se sont révélés fondamentaux. Ils comptent évidemment beaucoup au niveau européen, où la crédibilité économique donne un certain poids politique. C’est pourquoi je pense qu’il ne faut pas tout miser sur la coordination européenne et voir, au contraire, chaque pays membre « remettre sa maison en ordre » pour le bénéfice commun. A ce titre, l’éducation devrait être une priorité consensuelle, tant elle importe aujourd’hui et demain, dans un contexte d’éclosion de nouvelles technologies…
C.E. : Dans quelle mesure la politique macroéconomique aide-t-elle suffisamment à la croissance en Europe ? Pourrait-elle aider plus ? Il existe de nouvelles attentes vis-à-vis de la BCE…
M.M. : Sur la période récente, l’Europe a plutôt bien réagi aux crises. Depuis 2007-2008, elle a fait des relances budgétaires et du « quantitative easing ». Elle a mis en place le Mécanisme européen de stabilité (MES) et créé l’Instrument de protection de la transmission (IPT) de la politique monétaire (qui prévoit le rachat par l’Eurosystème, sur le marché secondaire, de titres émis dans des juridictions qui connaissent une détérioration des conditions de financement non justifiée par les fondamentaux propres à ces pays, NDLR). Beaucoup d’argent a été mis sur la table et tous les leviers n’ont pas encore été testés. Aujourd’hui, l’urgence est moins dans un « policy mix » plus accommodant que dans des plans d’investissement massifs qui sont particulièrement consommateurs de financement, en particulier en « equity » (actions / capital, NDLR). Or, les marchés de capitaux restent malheureusement sous-développés. Ainsi, la zone euro, qui dispose d’une épargne abondante, exportée en partie à l’étranger, n’est pas en mesure de la diriger vers ses besoins internes. Le manque d’intégration financière constitue indéniablement une partie du problème.
C.E. : Justement, l’Europe a comme priorité de mettre en œuvre l’agenda sur l’Union de l’épargne et de l’investissement (UEI), initiée depuis dix ans. Êtes-vous satisfaite de sa mise en œuvre ? Quelles doivent être les priorités aujourd’hui ?
M.M. : On observe certainement des progrès dans ce chantier important et il faut les saluer. Il faut cependant faire attention au discours que l’on adopte sur l’enjeu de l’intégration financière : dire que les Européens ne prennent pas de risques avec leur épargne me paraît erroné. L’Europe exporte bien du capital à risque en dehors de ses frontières, ce qui est une première façon d’indiquer son appétence au risque. De même, ses dépôts bancaires servent à financer des PME, qui portent des projets risqués. Quant aux placements en assurance-vie, ils financent les dettes des États, qui permettent d’assurer, au moins partiellement, un bon fonctionnement de l’économie. Il n’y a donc pas d’un côté du capital improductif et de l’autre, du productif. Cela étant dit, il est certain que l’Europe a besoin de plus de capital à risque mais on doit faire attention à la façon de l’obtenir. Des prises de risques individuelles peuvent être inadaptées, alors que les solutions plus mutualisées, portées par des fonds de pension, comme il en existe dans les pays nordiques, sont sans doute meilleures.
C.E. : Sur le volet supervision de l’UEI, quelle est la bonne méthode pour aller de l’avant ? Centraliser la supervision au niveau de l’ESMA, comme le veulent les autorités françaises et la Commission ou envisager une solution où la supervision serait répartie par « hubs » connectés, comme le préconise, par exemple, Nicolas Véron, de Bruegel ?
M.M. : Dans un monde idéal, il faudrait certainement un marché financier unique et une union bancaire unique. Et dans ce monde idéal, il y aurait une seule autorité et pas de multiples autorités de supervision des marchés. Cela dit, il est possible d’imaginer une étape de transition qui impliquerait différents organismes nationaux, comme on l’a vu dans d’autres domaines. Ceci n’est qu’une question de mise en œuvre alors que la priorité réside dans l’enjeu fondamental : quelle est la volonté politique réelle derrière la mise en place de l’Union de l’épargne et de l’investissement ? Prenons l’exemple de l’euro : une fois que la décision de le faire a abouti, les discussions techniques sur ses modalités, ses étapes, etc., ont suivi. Aujourd’hui, on discute plus du « comment » que du « quoi » en ce qui concerne le marché unique des capitaux. C’est dommage, car nous avons besoin de perspectives claires au-delà du seul enjeu de la supervision.
20251218-Entretien-avec-Michala-Marcussen-Chef-eeconomiste-du-groupe-Socieetee-Geeneerale-et-Directrice-des-eetudes-eeconomiques-et-sectorielles