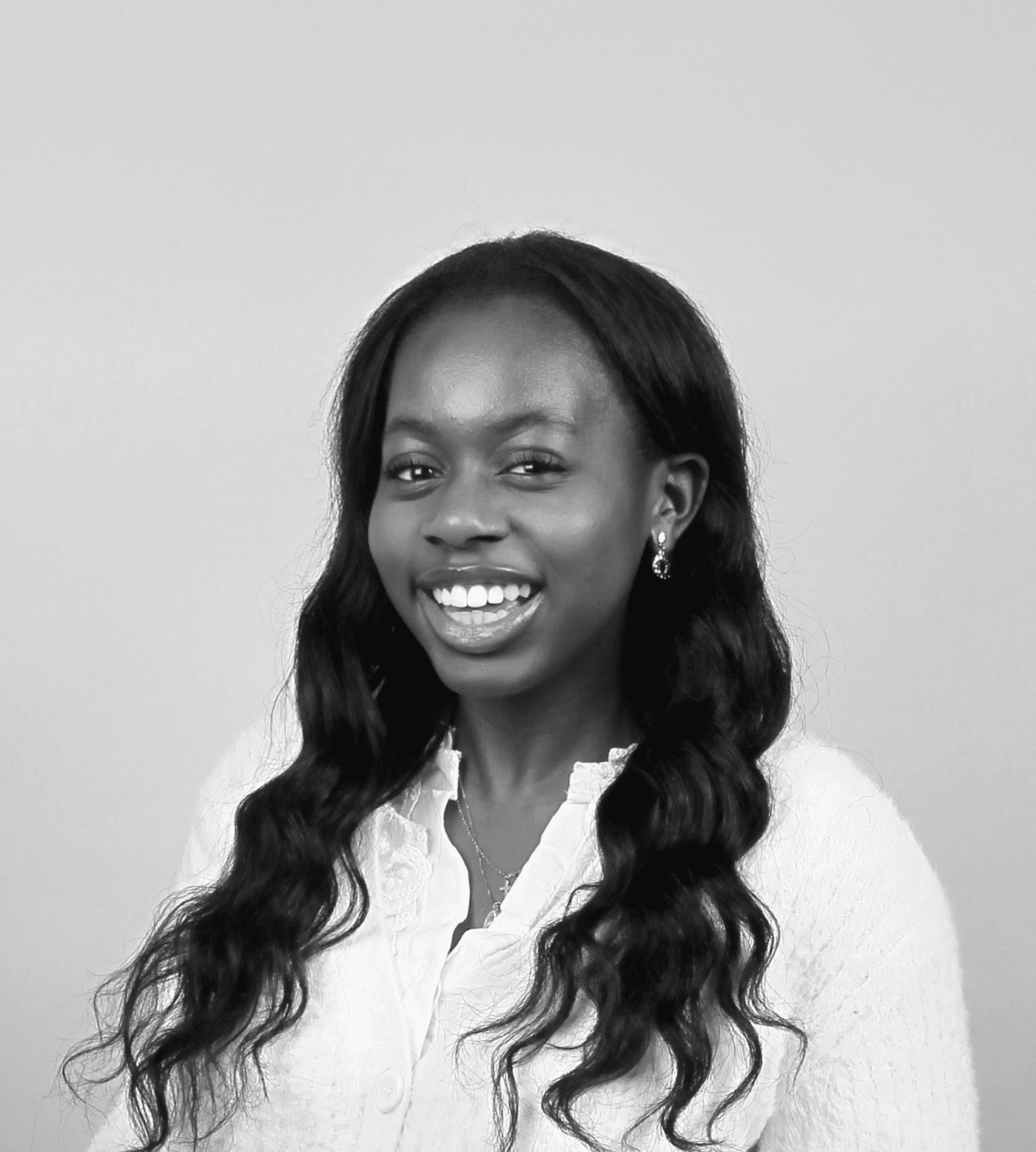Entretien de Confrontations Europe avec Denis Charbit, professeur à l’Université ouverte d’Israël
Le mouvement civique contre la réforme du système judiciaire en Israël ne faiblit pas depuis
plusieurs mois, alors même que des mesures clefs de la réforme viennent d’être adoptées par la
Knesset. Dans un entretien accordé à Confrontations Europe, Denis Charbit, professeur de
science politique à l’Université Ouverte d’Israel (Ra’anana) analyse l’impact de cette réforme sur
l’avenir de la démocratie israélienne et ses liens avec l’Europe.
♦ En janvier dernier, Yariv Levin, Ministre israélien de la justice formulait pour la première fois sa proposition de réforme de l’institution judiciaire, depuis lors tant contestée par une large partie de la population et de la classe politique. Celle-ci prévoit notamment une refonte profonde de la Cour Suprême, garante en Israël de la constitutionnalité des lois et des respects des principes démocratiques, gravés dans l’identité originelle de l’Etat d’Israël. Ce faisant, dans quelle mesure le changement du processus de nomination des juges et la mise en application d’une clause dérogatoire aux décisions de la Cour suprême mettent-ils à mal les fondations démocratiques sur lesquelles l’Etat israélien s’est bâti à partir de 1948-49 ?
Denis Charbit : En effet, comme vous le dites justement, les principes démocratiques étaient
gravés dans l’identité originelle de l’Etat d’Israël et figuraient dans les propositions de
l’Assemblée constituante chargée d’élaborer une Constitution. C’est dans la déclaration
d’Indépendance proclamée par Ben Gourion, le 14 mai 1948 qu’on les trouve, et c’est d’autant
plus remarquable que le mot « démocratie » n’y figure pas en toutes lettes et que l’institution
judiciaire n’y est pas même mentionnée. Et si l’on s’en tient aux circonstances elles-mêmes de la
déclaration, Ben Gourion a proclamé ces principes démocratiques après six mois de combat
avec les milices palestiniennes et à la veille de la déclaration de guerre effectuée par cinq
Etats arabes. Seulement voilà, déclaration d’indépendance ne vaut pas Constitution. La
première consigne admirablement les raisons d’être d’un Etat juif en Palestine; elle fixe le cadre
normatif dont se réclament d’ailleurs les manifestants depuis janvier dernier. Mais c’est une
Constitution qui grave dans le marbre les principes. Si Ben Gourion s’était seulement contenté
de retarder l’échéance de sa rédaction, passe encore; qu’il n’ait pas fixé de date-butoir, voilà la
tare originelle. Après la guerre, l’heure viendrait de bâtir l’Etat, et face à une tâche d’une telle
ampleur, il a préféré ne pas s’embarrasser d’un contrôle qui aurait entravé l’action législative de
la Knesset (le Parlement israélien). Toutefois, Ben Gourion a mis en place la Cour suprême qui a
fonctionné depuis 1949 comme cour de Cassation et comme Haute Cour de Justice autorisée à
examiner et à disqualifier toute action prise par l’appareil d’Etat, administration comprise.
C’est ainsi que les droits et les libertés fondamentales ont été garantis, non par une Déclaration
de droits inscrite dans la Constitution qui n’existe toujours pas, mais par la jurisprudence. Encore
un peu d’histoire pour comprendre le présent: un système démocratique a donc été mis en
place, caractérisé par la suprématie de la Knesset et des lois qu’elle promulgue sans contrôle
d’un Conseil constitutionnel, avec le suffrage universel comme justification de cette suprématie.
Pour que ce système fonctionne, il a suffi que tous les chefs de gouvernements et toutes les
coalitions parlementaires agissent avec tempérance et admettent que si, en théorie, ils peuvent
voter n’importe quel loi, de fait ils s’en abstiennent et usent de leur pouvoir de législation de
manière raisonnable.
En 1995, un tournant majeur a été opéré. A la faveur de deux lois fondamentales qui avaient été
promulguées trois ans plus tôt et qui avaient été les premières à porter sur les droits et libertés
des citoyens (Loi fondamentale sur « la liberté de l’emploi », loi fondamentale sur « la dignité de
l’homme et sa liberté », 1992), la Cour suprême a estimé que leur statut constitutionnel qui leur
avait été conféré autorisait désormais la Cour suprême à remplir le devoir de contrôle des lois
ordinaires de la Knesset. Ce tournant a permis d’ajuster la démocratie israélienne au rang des
démocraties qui établissent un équilibre entre le pouvoir judiciaire et les pouvoirs législatifs et
exécutifs, lesquels se recoupent dans un système parlementaire, en accordant au premier la
fameuse judicial review. Cet interventionnisme, la Cour suprême l’a effectué à vingt-trois
reprises depuis 1995. Dans la plupart des cas, les modifications réclamées par les juges ont été
formalistes et techniques. Dans cinq cas seulement, les juges ont annulé des lois en invoquant
des motifs légaux interprétés dans un sens libéral.
Cette révolution constitutionnelle a été vite perçue par le Likoud et les partis religieux comme
l’instauration d’un « gouvernement des juges ». Ils rongeaient leur frein cependant car les
majorités parlementaires dont ils faisaient partie incluaient toujours une ou plusieurs formations
politiques situées au centre-droit et qui posaient comme condition à leur entrée dans la
coalition, le gel de toute réforme relative à la justice. C’est lors du dernier scrutin, le 1er
novembre 2022, que les conditions politiques ont été créées pour remettre en cause
l’indépendance de la Cour suprême puisque la coalition composée de quatre formations
politiques était enfin en état de passer à l’acte et de décréter cette contre-révolution judiciaire
après trente ans de « révolution constitutionnelle ». Qu’on en juge: le gouvernement a obtenu
l’investiture de la Knesset le 29 décembre, et c’est le 4 janvier 2023 – six jours plus tard – que le
ministre de la Justice, Yariv Levin, a présenté son projet de loi. C’est dire comme l’ardeur était
vive. Sous prétexte de renforcer la volonté du peuple et la capacité d’action de l’Exécutif, il
s’agit de réduire, sinon de supprimer les capacités d’intervention de la Cour à tous les niveaux.
Si le projet est adopté, on ne sera plus dans un modèle libéral de séparation des pouvoirs, mais
dans un modèle de concentration des pouvoirs entre les mains de l’Exécutif, avec une Cour
suprême paralysée et neutralisée.
Cette suprématie du Parlement que souhaite rétablir Yariv Levin est une régression par rapport
à la marche des démocraties libérales qui, peu ou prou, se sont toutes alignées sur une
définition de la démocratie plus substantielle que la règle de la majorité. Mais le gouvernement
n’entend pas seulement revenir au statu quo qui prévalait jusqu’en 1995. Ce n’est pas seulement
la toute-puissance législative de la Knesset qu’il entend restaurer. Il exige de peser sur le mode
de recrutement des juges en veillant à ce que l’autorité politique détienne le contrôle de la
commission chargée de les désigner. Mieux encore, la capacité de la Cour suprême de
contrôler l’action gouvernementale est visée elle aussi. Seulement, la société civile israélienne
s’est émue de ce coup de force tenu pour une violation du contrat démocratique, et ce quand
bien même une majorité de parlementaires (64 sur 120) l’aurait voté en bonne et due forme. Ce
duel explicite l’âpreté du débat: légalité contre légitimité. Le projet de réforme est légal
puisqu’une majorité de députés va l’entériner, disent les partisans du gouvernement. Or, tout ce
qui est légal n’est pas légitime, à plus forte raison lorsque le projet en question vise à changer
les règles du jeu, lesquelles ne sont modifiables qu’en s’appuyant sur une majorité qualifiée des
députés, et non sur une majorité absolue.
Après un temps de surprise est venu le temps de la protestation. Celle-ci n’a pas été menée par
les partis de l’opposition. C’est de la rue qu’elle est née et qu’elle a éclaté. Trois mois plus tard,
devant la pression publique intérieure, les avertissements émis par les élites économiques et les
experts, les pressions émanant des réservistes militaires (notamment dans l’armée de l’air, et
dont le concours est indispensable pour garantir la supériorité aérienne d’Israël), les mises en
garde de la Maison Blanche et le trouble des communautés juives en diaspora, Netanyahou a
fini par reculer en ordonnant la suspension de la législation avant le vote définitif en troisième
lecture. Pendant trois mois, des pourparlers entre représentants de la majorité et de l’opposition
ont été noués, mais ont tourné court. Depuis le mois de juin, le travail législatif a été remis en
action. L’unique concession faite à cette date est que les divers volets du projet ne seraient plus
votés en bloc, mais, un par un. Autrement dit, pour ne pas donner prise à l’accusation de
chercher à « renverser le régime », la coalition procèderait au coup par coup afin d’affaiblir
l’opposition. Car si le vote du projet en bloc justifiait cette appréhension, il est plus difficile de
soutenir un tel soupçon lorsqu’on n’en retiendrait plus qu’un ou deux éléments de la réforme.
En coupant en rondelles le bloc de réformes, il est transparent que le changement est purement
tactique. Netanyahou ne cherche pas à geler la situation judiciaire, mais à contenir ses effets à
haut risque. Au lieu de faire en sorte, à l’instar de tout gouvernement démocratique, que les lois
et les décisions soient compatibles avec les règles, le gouvernement vise à supprimer les garde-fous. Il prétend que le renforcement de l’Exécutif ne saurait être tenu pour une mise en cause du régime démocratique. Il reproche au mouvement civique de crier à la fin de la démocratie et n’y
voit qu’une manœuvre de l’opposition pour acculer à la démission un gouvernement
démocratiquement élu. C’est donc pour le gouvernement un refus du suffrage universel qui
s’exprime dans cette protestation, tout le contraire d’une défense de la démocratie.
Pour trancher cette question, il importe de s’interroger sur plusieurs points : quelle est la raison
d’être du projet ? Que veut faire le gouvernement une fois qu’il se sera affranchi de cette tutelle
pesante de la Cour suprême qui pèse au-dessus de lui comme une épée de Damoclès ?
Jusqu’où va ce rééquilibrage et ne conduit-il pas à un déséquilibre plus risqué encore ? C’est là
la question. Nul besoin toutefois de sonder les arrière-pensées des députés de la coalition pour
discerner les intentions qui président à cette contre-révolution: s’ils présentent mains et mains
défauts, on ne saurait leur reprocher d’être des dissimulateurs. Depuis la publication du résultat
des élections du 1er novembre dernier, outre la joie d’être parvenus à constituer une majorité
homogène – ce qui n’était guère arrivé depuis les cinq élections successives organisées entre
2019 et 2022 – les députés de la coalition se sont sentis investis d’une mission providentielle et
n’ont eu de cesse de déclarer à cor et à cri les intentions et les projets, immédiats et à long
terme, qu’ils s’efforceraient de traduire en lois et en action politique durant les quatre années à
venir. A les entendre, quelqu’un qui ignorerait tout de la vie politique israélienne pourrait croire
que cette coalition arrivait au pouvoir pour la première fois après des décennies passées dans
l’opposition.
Le projet commun aux quatre formations politiques constitutives de la coalition gouvernementale comporte trois volets :
- passer d’un Etat juif à un Etat théocratique ;
- passer d’une colonisation rampante à une colonisation accélérée ;
- placer leurs militants dans l’appareil d’Etat, et faute d’avoir les compétences requises, assouplir les exigences pour entrer dans la fonction publique.
Il faut dire que le problème du Likoud, comme des partis orthodoxes, leur échec historique, est
de ne pas être parvenus, depuis déjà un demi-siècle, à former des élites à partir du vivier de
leurs militants en grand nombre. D’où la nécessité d’assouplir les critères.
Or, l’obstacle majeur aujourd’hui à la théocratie rampante, à la colonisation massive et à la
corruption reste et demeure la Haute Cour de Justice, à laquelle on peut ajouter l’autorité du
conseiller juridique du gouvernement. Faute d’être parvenu à faire voter en deuxième et
troisième lecture le projet de loi visant à restructurer la commission de recrutement des juges en
attribuant la part belle au gouvernement et au Parlement, le président de la Commission des lois
a jeté son dévolu sur une réforme, en apparence moins significative, concernant le critère de «
non-raisonnable » d’une loi de la Knesset, d’une nomination ou d’une décision prise par un
ministre, le gouvernement ou l’administration. Ce critère est invoqué lorsque les juges
considèrent qu’en dépit de la légalité de la procédure, une décision pourrait être annulée si elle
présente un caractère « déraisonnable à l’extrême ».
Yariv Levin dénonce une porte ouverte au « gouvernement des juges ». La Haute Cour estime que
pour éviter les abus de la part du législateur et du gouvernement, toujours soucieux de satisfaire
leurs électeurs et de lever des obstacles, il est capital de poser une borne pour rappeler la
primauté du droit. Cette borne est désormais révolue à moins que la Cour suprême qui a été
saisie pour se prononcer début septembre n’annule la loi. Rien n’est moins sûr: il s’agit d’une Loi
fondamentale. Or, à ce jour, seules des lois ordinaires ont été annulées. Il n’est pas exclu que la
Cour suprême maintienne certaines dispositions de la loi et en déclarent d’autres incompatibles
avec l’Etat de droit, notamment sur ce qui touche aux nominations dans la fonction publique. En
résumé, la bataille n’est pas finie, mais on s’accorde à penser que le projet initial préconisé par
le ministre de la Justice en janvier dernier est révolu. Il devra attendre une victoire de la coalition
sortante aux prochaines élections (en 2026) pour décréter que son projet a été légitimé par le
verdict électoral.
Quant à l’opposition au Parlement et dans la rue, elle n’estime guère que la loi votée en juillet et
celle qui le sera à l’automne ne sont que des souris inoffensives dont aurait accouché la
montagne où s’est hissé Yariv Levin parvenu au sommet de ses ambitions en obtenant le
ministère de la Justice. Le blitz initial étant compromis, l’opposition extra-parlementaire est
engagée dans une course de marathon dont nul ne saurait prédire l’issue: un sursaut
démocratique ou, de l’Etat de droit israélien, le premier râle d’une mort lente.
♦Depuis l’annonce de la réforme et dans le prolongement des vifs débats qui parcourent la
société israélienne, plusieurs Etats et organisations alliées à l’image des Etats-Unis, de l’Union européenne ou de l’Allemagne, les craintes de voir Israël s’éloigner de son modèle démocratique historique se font croissantes parmi les autres démocraties occidentales. Cela est tout particulièrement vrai vis-à-vis de l’Union européenne qui s’est émue de voir l’institution judiciaire à ce point remise en cause. Doit-on en conclure un inévitable isolement progressif d’Israël vis-à-vis de ses partenaires européens ? Cette érosion de la démocratie israélienne risque-t-elle à son ton tour d’impacter l’Union européenne, en insufflant un nouvel élan d’illibéralisme ?
D.C. : Les relations entre Israël et l’Union européenne sont marquées depuis plusieurs décennies
par une ambivalence certaine. D’un côté, la coopération économique et scientifique entre les
deux partenaires est de plus en plus accrue. De l’autre, le différent permanent autour de la
question palestinienne – la colonisation, l’occupation, les violations des droits de l’homme et un
processus de paix au point mort – jette une ombre à ce tableau positif et altère une relation qui
aurait pu être infiniment plus harmonieuse. Cette contradiction conduit à la frustration de la
part des Européens qui souhaiteraient remplir un rôle plus actif dans la région et à la crispation,
côté israélien, face à une attitude européenne qu’elle juge déséquilibrée, dogmatique et
dépassée depuis sa formulation initiale dans la Déclaration de Venise qui remonte à 1980. L’ère
Netanyahou en la matière a été marquée par une volonté de modifier le rapport de forces pour
contourner les pressions diplomatiques européennes sur Israël en s’appuyant sur les pays du
groupe de Visegrad – Pologne, Hongrie, République tchèque et Slovaquie. Depuis qu’ils se sont
émancipés de la tutelle communiste, ces pays ont non seulement établi des relations
diplomatiques avec Israël, ils ont également rompu avec l’héritage soviétique qui imposait un
soutien unilatéral et absolu à la cause palestinienne.
Face à ce rapprochement progressif subsistait un obstacle majeur pour les Israéliens, sinon pour
l’Etat d’Israël : le moins qu’on puisse dire c’est que le travail de mémoire opéré par ces pays à
propos de leur attitude durant la Shoah laissait à désirer, à plus forte raison si on le compare à
celui effectué par l’Allemagne, la Belgique, la France et l’Italie. On y réhabilitait souvent des
héros nationalistes qui n’avaient pas été avares de préjugés envers les juifs, voire pénétrés
d’idéologie antisémite. Et cependant, une sorte de marché discret avait été contracté : en
échange d’une attitude plus favorable à Israël au sein de l’Union européenne et dans les
instances internationales, le gouvernement était disposé à fermer les yeux sur leur attitude
souvent ambigüe à propos de l’antisémitisme passé et présent, au mépris parfois des
avertissements des responsables des communautés juives dans les pays concernés.
Mais voilà que se dessine depuis quelques années, en plus de cet intérêt bien compris justifié
par la raison d’Etat, une convergence de vue inédite de nature idéologique. Ce n’est donc plus
seulement une affaire d’intérêts bilatéraux, mais bien une sympathie réciproque qui consiste à
épouser un discours idéologique à peu près identique avec des adaptations locales nécessaires.
Ce mélange d’autoritarisme et de populisme résulte d’une mise en cause du libéralisme politique
et des valeurs libérales. La droite israélienne n’a pas été la première à initier cette tendance,
mais on peut voir à travers l’histoire du Likoud comment la tendance libérale autrefois
hégémonique s’est réduite comme une peau de chagrin jusqu’à disparaître complètement. Il
reste bien quelques figures, mais elles ne constituent plus à elles seules un courant à part
entière.
Si Israël n’a pas été l’instigatrice de cette métamorphose, si elle s’inscrit bien dans cette vague
qui touche les démocraties en Europe et dans les Amériques, elle pourrait bien prétendre
devenir un modèle. C’est que la nation en Israël est culturelle, et non civique. Il y règne une
conception souverainiste de l’Etat et une méfiance envers le multilatéralisme. Par sa situation
géopolitique, le primat de l’armée et de la sécurité est intouchable. Enfin, l’Etat accorde un
statut privilégié à une cléricature religieuse et lui concède une autorité, proprement
inconcevable dans les pays libéraux. Tous ces éléments une fois mixés à la sauce populiste
pourraient bien susciter imitation et admiration au sein d’une Internationale populiste et
autoritaire à venir.
Netanyahou ne s’est-il pas targué d’être l’interlocuteur et ami de Jaïr Bolsonaro, Viktor Orban,
Vladimir Poutine et Donald Trump? Cette convergence ne s’effectue pas au nom du monde
libre, mais de « la civilisation judéo-chrétienne », laquelle désigne implicitement l’exclusion de
l’Islam, bien qu’il soit tout autant que les deux premières une religion monothéiste. Il en ressort
un conservatisme radical qui part en guerre contre tout ce qui se réclame du progrès, des droits
et des libertés. Israël n’est pas la seule ni la première à expérimenter cette bascule dans la
démocratie illibérale. Mais outre l’idéologie, n’est-ce pas surtout les mêmes pratiques et les
mêmes fins qui les unissent ? N’y voit-on pas la réalisation du même agenda: la mise au pas de
l’institution judiciaire, de l’administration publique, du service public de l’Information, de
l’Instruction publique, de l’Enseignement supérieur, des Beaux-Arts et des Belles-Lettres ? Pas en
une fois, pas d’un seul coup, mais petit à petit, afin de museler celles et ceux qui se révèlent plus
sensibles à l’universel, à la liberté, à l’individu plutôt qu’aux particularismes, aux contraintes et
aux communautés.
La situation israélienne est à la fois plus grave que celle de ses homologues d’Europe centrale,
et cependant moins désespérée:
Plus grave, car le projet illibéral israélien ne consiste pas seulement à imprimer à Israël une
orientation ultra-conservatrice dans le but de restreindre les droits des minorités ethniques, des
femmes et des homosexuels: il s’articule à un projet théocratique et colonialiste, ce dont sont
exempts les cas hongrois et polonais, même si dans ce dernier cas on ne saurait négliger
l’impact spécifique de l’Eglise catholique conservatrice;
Plus grave également, car quoi qu’on en dise, la Hongrie et la Pologne n’ont pas quitté l’Union
européenne, et celle-ci pèse encore sur ses deux « enfants terribles » et récalcitrants et pourrait
éventuellement procéder à des sanctions. (A maints égards, on peut comparer le rôle de
l’administration démocrate aux Etats-Unis à celui de l’Union européenne. Tous les deux
disposent de leviers d’influence sur leurs alliés tentés par l’aventurisme populiste);
Plus grave enfin, car les tendances démographiques lourdes en Israël tendent à renforcer le
poids électoral du bloc nationaliste et religieux au pouvoir, au détriment des forces libérales
condamnées dès lors à rester dans l’opposition. Certes, il faut se garder de réduire le scrutin à
la reproduction pure et simple d’indicateurs démographiques. Ainsi, le taux d’abstention parmi
les Palestiniens d’Israël et parmi les Juifs séculiers pourrait baisser si l’action gouvernementale
n’offre rien d’autre comme bilan que ce combat législatif.
Et cependant, la situation paraît moins désespérée en Israël. C’est que la transformation du
régime en Hongrie et en Pologne a eu lieu. La révolution conservatrice a été accomplie et seule
une victoire électorale des forces libérales dans ces deux pays est susceptible de changer la
donne. L’opposition parlementaire et extra-parlementaire en Pologne et en Hongrie, malgré son
impressionnante mobilisation, a été neutralisée. Elle peut retrouver un second souffle, mais elle
semble actuellement à bout de souffle.
En Israël, il est encore trop tôt pour prononcer un verdict. Il n’est pas exclu que le compte à
rebours qui signera la chute inexorable de la démocratie israélienne ait commencé; il n’est pas
impossible non plus que la conjugaison des effets économiques, des pressions américaines et
des communautés juives diasporiques, des impacts sur la sécurité israélienne et du climat social
dégradé parvienne à limiter le changement de régime à une ou deux réformes vidées
intégralement ou partiellement de leur potentiel dévastateur. Même les plus pessimistes effrayés
par la force de frappe d’un Ben-Gvir et d’un Smotritch conviennent que la protestation civique
n’a pas encore dit son dernier mot.
La mobilisation a surpris non seulement les manifestants, mais le gouvernement et la coalition.
D’une réforme en bloc, on est passé à une première loi promulguée et à une seconde déjà
approuvée en première lecture et susceptible d’être votée à l’automne, puis une pause plus ou
moins durable jusqu’aux nouvelles élections. Outre la protestation émanant de la société civile,
la Cour suprême exerce son autorité jusqu’à nouvel ordre selon les règles en vigueur
respectueuses de la séparation des pouvoirs. Malgré les menaces dont elle est l’objet, loin d’être
intimidée, elle persiste et signe comme elle vient de le démontrer à deux reprises, en juillet
dernier, en annulant deux lois récemment promulguées par la Knesset. La première portait sur la
modification de la loi sur les élections municipales et la seconde sur la possibilité pour l’Etat de
retenir une partie des avoirs d’un travailleur immigré qui aurait quitté le territoire au-delà de la
date d’expiration de sa carte de séjour.
Si la vague populiste, nationaliste, théocratique et suprémaciste en Israël finit par l’emporter,
cette victoire constituera un encouragement pour les partis de la même famille idéologique en
Europe. Ceux-ci sont bien conscients que la question de leur légitimité, qui reste toujours
suspendue sinon contestée au nom du passé, pourra être résolue en partie s’ils obtiennent une
reconnaissance de la part des autorités israéliennes, selon les termes évoqués plus haut: soutien
à la colonisation de la Cisjordanie, reconnaissance de Jérusalem comme sa capitale unifiée en
échange d’une condamnation formelle de l’antisémitisme. Le triomphe du national-populisme en
Israël ne sera pas sans conséquences sur les populismes européens stimulés dans leur marche
au pouvoir et affectera les relations privilégiées avec les pays libéraux de l’Union européenne.
On assisterait alors à un renversement de l’Histoire: le sionisme et l’Etat d’Israël qui se sont
appuyés depuis leur émergence sur les Etats de droit libéraux trouveraient désormais leur
soutien parmi les forces politiques anti-libérales. Autrement dit, on aura soutenu Israël parce
qu’on était libéral, de gauche et de droite; désormais on soutiendra Israël parce que l’on est
populiste, nationaliste et ultra-conservateur.
Raison de plus pour que la vague populiste et nationaliste en Europe et en Israël trouve face à
elle un front uni pour la défense de l’Etat de droit, de la démocratie et du libéralisme politique.
♦Un autre enjeu de taille auquel la démocratie israélienne se trouve confrontée est la question de sa relation avec l’Autorité palestinienne et l’éloignement de la perspective d’une solution à deux Etats. La multiplication des colonies dans les territoires occupés par l’armée israélienne tend aujourd’hui à générer de plus en plus de préoccupations et d’accusations sur la scène internationale quant à l’existence d’une “situation d’Apartheid” dans ces territoires. Dès lors, dans quelle mesure la relation de l’Etat d’Israël avec les Autorités palestiniennes est-elle déterminante pour la préservation du caractère démocratique de celui-ci ?
D.C. : Le gouvernement actuel, comme tous ceux qui l’ont précédé depuis 2014, estime que les
conditions ne sont guère propices pour la reprise des négociations interrompues depuis la
mission Kerry, la dernière à avoir réuni les deux parties en vue d’un accord de paix définitif. Le
prétexte le plus souvent invoqué est la complicité supposée de l’Autorité palestinienne avec le
terrorisme sous prétexte que celle-ci attribue une solde aux familles des combattants, détenus
ou morts au champ d’honneur de la lutte palestinienne. Le discours public répété à l’envi affirme
que la paix ne sera pas l’œuvre de la génération actuelle, mais celle des générations futures.
L’impact de ce discours sceptique sur les chances de parvenir à la paix avec les Palestiniens,
après l’échec de deux décennies de pourparlers sans résultat probant, est tel que même les
partis de gauche et de centre-gauche se gardent d’employer le terme d' »occupation » trop
chargé, selon eux, puisqu’il est le mot-clé du lexique politique de l’ennemi.
Lorsqu’ils ont exercé le pouvoir pour une courte période de dix-huit mois, Naftali Benet et Yaïr
Lapid avaient prévenu que le gouvernement du changement qu’ils ont présidé successivement
n’allait procéder ni à l’annexion ni au retrait des territoires afin d’éviter l’éclatement de leur
majorité parlementaire particulièrement éclectique sur ce thème hautement controversé. Tout
au plus Lapid a-t-il mis en garde contre la perspective dangereuse que constituerait pour Israël
l’établissement d’un Etat binational de la Méditerranée au Jourdain ou contre le risque
d’apartheid si Israël procédait à une annexion unilatérale des territoires occupés sans accorder
le droit de vote aux deux millions de Palestiniens qui y résident.
Ce discours critique dissimule mal la difficulté à assumer ouvertement la solution à deux Etats,
convenant implicitement que cette solution n’est plus viable depuis que près de 600 000 Juifs
vivent dans les territoires occupés (ce chiffre inclut les habitants juifs de Jérusalem-est).
A cet égard, la protestation qui s’est soulevée contre les menaces pesant sur l’indépendance de
la Cour suprême a permis de rompre un tant soi peu avec l’intimidation idéologique et politique
ambiante décrite plus haut. Nombre de manifestants qui redoutent la fin de la démocratie en
Israël et l’avènement d’un régime autoritaire, voire d’une dictature, se sont interrogé sur les
conditions qui président à l’existence d’une démocratie véritable. La réponse qui a été donnée
est bien que la séparation des pouvoirs, autrement dit, le maintien des prérogatives de la Cour
suprême, est une condition indispensable et irréductible à toute espèce de compromis. Pour
mobiliser l’opinion, il était prévisible que surgisse tôt ou tard, en parallèle à des slogans tels que
« pas d’université sans démocratie », « pas de santé publique sans démocratie », une injonction plus
radicale encore : « pas de démocratie s’il y a occupation ».
Certes, l’Histoire européenne récente nous rappelle que des régimes démocratiques ont pu
s’épanouir alors qu’ils exerçaient outre-mer une domination impériale et coloniale simultanée. Il
est incontestable que la décolonisation des empires britannique et français a principalement
résulté du fait qu’en 1945 ces deux pays n’occupaient plus dans le système international la place
de superpuissance qu’ils détenaient dans l’entre-deux guerres. Et cependant, même si le poids
de la pression extérieure et intérieure n’a pas été déterminant, même si donc un Etat
démocratique peut exercer une domination sur un territoire qui ne bénéficie pas du cadre
démocratique en vigueur en métropole, il n’en reste pas moins vrai que la contradiction entre
système démocratique et système colonial finit par éclater. Il a fallu près d’un siècle de
république pour que la France s’en rende compte, se ressaisisse et mette fin à ce régime
hybride – démocratique dans l’Hexagone, colonial dans l’empire français – qui n’était plus
moralement viable.
Ce faisant, même si on ne s’est pas rendu aux carrefours d’Israël tous les samedis soirs dans le
but de protester contre l’occupation et la colonisation, encore moins pour réclamer la solution à
deux Etats, il est indéniable que la présence de la tendance nationaliste, théocratique et
suprémaciste au sein du gouvernement, incarnée à des postes-clés par Ben-Gvir et Smotrictch
(la Police et les Finances), a rendu possible, après des années d’intimidation idéologique, la
reprise d’une interrogation lancinante sur l’incompatibilité entre une démocratie digne de ce nom
et un régime d’occupation militaire sur lequel se greffe une annexion accélérée.
A la longue, une démocratie au service de ses citoyens, mais qui tient sous sa coupe une autre
population par le biais d’une autorité militaire, ne tient pas la route, à plus forte raison lorsqu’il n’y
a plus même de négociation pour rappeler aux occupants et aux occupés que l’occupation est
provisoire, avant qu’elle n’aboutisse à une solution équitable. Cette paix signera la fin d’un
contentieux historique entre le peuple juif et la nation arabe en général, et le peuple palestinien
en particulier.
Mais ce que l’on saisit aujourd’hui à travers ce projet de réforme, bien plus que par le passé,
c’est que la paix, outre la fin des violences réciproques, apportera à la démocratie israélienne
en tant que telle la meilleure garantie de sa stabilité et de son épanouissement. Plus que jamais
on comprend de nos jours ce que l’on a tardé longtemps à comprendre, à savoir que le projet
de colonisation et d’annexion ne peut se réaliser sans mettre en péril l’Etat de droit et la
démocratie. Autrement dit, l’avenir de l’Etat d’Israël passe non seulement par le maintien des
prérogatives dont dispose la Cour suprême ou encore la promulgation d’une Constitution écrite,
mais aussi par le démantèlement du régime d’occupation. Celui-ci n’est viable que s’il est
provisoire et que sa disparition soit son inéluctable destinée. Aussi la protection de la
démocratie israélienne ne dépend pas tant de la nature de « la relation avec l’Autorité
palestinienne », mais plus précisément de la remise en branle de « la perspective de la solution à
deux Etats ».
Certes, le leadership du mouvement civique est exposé à un dilemme politique : pour assurer sa
victoire faut-il veiller en priorité à rallier des gens de droite et des religieux attachés au maintien
d’Israël dans les territoires ou bien convient-il de se passer de ce ralliement au nom de la pureté
idéologique et de l’incompatibilité entre le projet colonial et le projet démocratique ? Il semble
que la direction actuelle du mouvement penche plutôt pour un réflexe politique pragmatique.
Ce n’est qu’en parvenant à montrer, sondages d’opinion à l’appui, qu’une partie de l’électorat
nationaliste ou religieux déserte le gouvernement et la coalition que ceux-ci s’inclineront et
changeront de stratégie.
On ne choisit pas la manière dont l’Histoire avance. Il faut, me semble–t-il, passer par les cases
« Cour suprême » et « Etat de droit » pour atteindre ensuite la case supérieure et mettre en
évidence que l’occupation est le poison mortel qui pèse sur l’avenir de la démocratie israélienne,
et dont la réforme judiciaire préconisée n’est que le moyen.
Denis Charbit, Professeur de science politique à l’Université Ouverte d’Israel (Ra’anana).
Dernier livre paru: Israël et se paradoxes. Idées reçues sur un pays qui attise les passions, 2023,
Paris, éditions Le Cavalier bleu